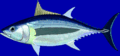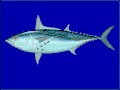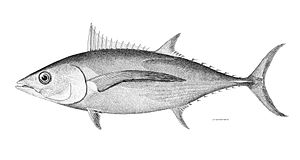-
Le terme thon désigne plusieurs espèces de poissons océaniques de la famille des Scombridae, dont les thons rouges, le thon blanc – ou germon –, le thon albacore, le thon patudo et le thon listao. Ces trois derniers sont des thons tropicaux.
Le thon est un animal marin très largement disponible et le risque de surpêche est grand. La capture mondiale de thonidés est de l'ordre de 4,5 millions de tonnes par an[1]. Il est difficile de garder un thon captif ; l'Aquarium de la baie de Monterey est l'un des rares dans le monde à pouvoir en montrer.
Espèces
Cette famille de nageurs véloces (avec des records de 80 km/h) et de mangeurs voraces (chaque jour jusqu'à 30 % de leur poids en petits poissons ou crustacés) compte une douzaine d'espèces. Les voici par ordre décroissant de quantités pêchées :
- la bonite à ventre rayée ou listan ou listao (Katsuwonus pelamis) est un thonidé tropical. C'est l'espèce de thon la plus pêchée avec 2,8 millions de tonnes en 2006 (60% des pêches de thon)[2].
- le thon jaune ou albacore (Thunnus albacares) est un thon tropical. Il a été observé en plongée à des profondeurs supérieures à 1 000 m au large des Seychelles et représente 24% des pêches.
- le thon obèse ou patudo (Thunnus obesus) (10% des pêches)[1].
- le thon blanc ou germon (Thunnus alalunga) est plus petit que le thon rouge et vit avec ce dernier. Il est pêché en surface.
- les trois espèces de thons rouges, les plus gros et peuvent atteindre jusqu'à une tonne.
- Le thon rouge du Nord ou thon rouge de l'Atlantique: Thunnus thynnus, présent dans l'Atlantique et la Méditerranée peut vivre 40 ans.
- Le thon rouge du sud : Thunnus maccoyii.
- Le thon rouge du Pacifique : Thunnus orientalis.
- le ravil (Euthynnus allettaratus), thon tropical.
-
Katsuwonus pelamis, bonite à ventre rayée
-
Thunnus latior (éocène)
Description
Les thons, de par leur grande taille, leur hydrodynamisme et leur bonne vision, sont des nageurs très rapides. Bien qu'ils soient poïkilothermes, ce sont les seuls poissons, avec certains grands requins, qui possèdent un système d'échangeurs de chaleur leur permettant de conserver au chaud leurs muscles et leurs viscères. Ce système est basé sur le contact entre des capillaires veineux, dont le sang est réchauffé par l'activité musculaire, et des capillaires artériels, dont le sang froid provenant des branchies se réchauffe au contact des capillaires veineux. Toutefois ce système n'est pas aussi élaboré chez toutes les espèces de thons et n'est pas aussi développé chez les jeunes que chez les adultes. Ce sont les grands thons rouges (pouvant dépasser 4 mètres et atteindre 700 kg) qui sont capables de fréquenter les eaux les plus froides, ils sont d'ailleurs pêchés jusqu'en Islande. À l'inverse de la plupart des espèces de poisson qui ont la chair blanche, celle des thons est souvent rose, du fait de leur importante vascularisation. Du fait de sa position de prédateur, et parce qu'il contient beaucoup de lipides, le thon rouge a tendance à accumuler des polluants tels que le mercure, métal très toxique.
Le thon est un infatigable migrateur, ce qui permet de le repérer lors des campagnes de pêche. Les bancs ou mattes rassemblent plusieurs milliers d'individus poursuivant des bancs de sardines, d'anchois, de sprats, de maquereaux, et méduses[3] dont ils se nourrissent.
Un aliment
Le thon est une source de protéines et contient peu de cholestérol. Le thon regorge d'éléments nutritifs, dont le phosphore, le sélénium, les vitamines A et D, ainsi que celles du groupe B. Le thon rouge se démarque du thon blanc par sa teneur élevée en acides gras oméga-3 dont l'acide eïcosapentaénoïque (EPA) et l'acide docosahexanoïque (DHA)[4]. Des études montrent que la consommation de thon a des effets favorables sur la santé cardiovasculaire et réduirait la mortalité par maladie cardiovasculaire.
Pour des raisons de conservation, le thon est souvent commercialisé en conserve. Au Japon, le thon est consommé cru sous forme de sushi ou de sashimi, des formes de préparation qui tendent à se populariser en Occident ; la partie ventrale, ou thon gras, étant la plus appréciée. De nombreux pays du Pacifique, des côtes africaines et de la Méditerranée pouvant le consommer frais, de nombreuses recettes existent, y compris crue ou en marinade de citron (voir notamment poisson cru à la tahitienne).
 votre commentaire
votre commentaire
-
-
-
Le Bégnat - Pêche à l'anchois - Ciboure - Saint... par ixa031
Le Bégnat - Thonier artisan - Ciboure - Saint Jean de Luz
envoyé par ixa031. - Explorez des lieux exotiques en vidéo.Bégnat Chasseur de thons - 1994
Bégnat - Chasseur de thons -1994- Partie 1
envoyé par ixa031. - Voyage et découverte en vidéo.
Bégnat -Chasseur de thons -1994- Partie 2
envoyé par ixa031. - Découvrez de nouvelles destinations en vidéo. 1 commentaire
1 commentaire
-
487
Le parcours exemplaire d’un pêcheur basque:
Jesús Larrarte Lecuona
Marc Larrarté
1922. La misère règne sur Fontarabie, très ancienne cité du Guipúzcoa. Certes, une évidente richesse
se manifeste sur le front de mer, où d’imposantes demeures mènent grand train et occupent du personnel
domestique. Ailleurs, pauvreté physique et détresse morale. Les chants parfois inspirés, toujours entonnés
avec conviction qui s’élèvent des cidreries où les pêcheurs tiennent leurs assises révèlent une folle désespérance:
chanter ou pleurer est indifférent, l’important étant de crier. Cantando la pena, la pena se olvida,
dira bientôt l’immense Antonio Machado.
Dans la famille Larrarte Lecuona, il ne s’agit même plus de misère mais d’une déroute intégrale. Celedonia,
mère au foyer, et Matías, vérificateur à la pesée, sont morts à quelques semaines d’intervalle.
Matiàs avait toujours rapporté à la maison assez d’argent pour qu’on vécût dignement. Désormais, plus
rien. Après l’intervention du curé de la paroisse, les quatre filles (Lucía, Valentina, Justina et María Begi txiki)
et les quatre garçons (Anastasio, Jesús, Juanito et Bixente) ont été répartis dans différentes familles, du
moins officiellement. Mais la réalité est quelque peu différente. Observons ce qu’il advient avec le deuxième
garçon, Jesùs, onze ans: il suit de temps à autre l’enseignement d’un vieux maître handicapé connu
comme maese cojo; le matin, il mène au pacage le bétail des personnes qui l’ont recueilli et il retourne le
chercher à la tombée du jour; cela mis à part, nul ne sait comment ce Jesùs-là passe ses journées.
Nous le savons aujourd’hui. Il rôde en quête de quelque chose à vendre ou à manger: des figues qui
pendent à des branches débordant sur la rue; des pommes ou des cerises dont la cueillette impose de sauter
un mur ou l’autre (quand il est surpris, Jesùs, espérant échapper aux réprimandes, s’invente un prénom,
Krispín, qui lui restera, et une fausse adresse). Il retrouve son frère aîné Anastasio et tous deux cherchent
un petit travail à faire pour les commerçants du bourg, livrer des hameçons, trimbaler des sacs de
patates ou d’oignons. Ils gagnent ainsi quelques perras chicas, quelques piécettes... Mais ce qui les intéresse
est d’aller à la pêche. Du temps même de leurs parents, ils ont découvert dans l’estuaire un battela
disjoint, enfoui dans la vase, grignoté par les étrilles. Ils l’ont remis en état de naviguer, sans lui donner le
moindre lustre, afin que d’autres impécunieux ne viennent pas le voler. Ils l’utilisent désormais pour capturer
des zapateros (dorades grises Spondyliosoma cantharus), des louvines (bars Dicentrarchus labrax),
des muges (mulets Mugil ramada) et des chipirons (encornets Loligo vulgaris) qui abondent dans la Bidassoa
et aux abords du cabo de Higuer et de l’ilôt Amuitz. Ainsi les garçons se procurent assez d’argent pour
que leurs frères et soeurs mangent tous les jours et n’aillent pas le derrière à l’air. Quelques pêcheurs professionnels
les aident, en leur abandonnant deux ou trois brasses de briña, une poignée d’hameçons, un
demi-seau de tripaille pouvant servir d’appât. Peut-être sentent-ils que les frères Larrarte ont déjà la vocation
halieutique.
L’idéal serait qu’un patron prenne Jesús ou Anastasio dans son équipage, en qualité de mousse. Mais
aucun ne le peut. La pêche, activité principale du bourg (avec l’agriculture), comprend deux classes distinctes.
Primo, certaines embarcations à vapeur, mais aussi à voiles, des txalupa handi montées par treize
hommes, appartiennent à des familles riches, également propiétaires d’usines, d’ateliers, de commerces et
de fermes. Une bonne part d’entre elles travaille sur des pêcheries lointaines, Grande Sole, Rockall, et
même sur les bancs morutiers. D’autres pratiquent une pêche semi-côtière, rapportant des cerniers (Polyprion
cernium), des raies pocheteaux (Raja oxyrenchus) et tous les beaux et bons poissons de ce littoral.
Pour être admis dans un tel équipage, il faut manifester des dispositions nautiques évidentes. C’est ce qu’il
adviendra, dans deux années, à l’aîné, Anastasio Larrarte. Mais, en général, embarquent à bord de ces
bateaux-ci les fils, petits-fils, neveux et frères cadets de ceux qui y naviguent déjà.
Secundo, il existe une quarantaine d’embarcations, itsas jendeen untziak, appartenant à ceux qui
pêchent. Armer de telles unités n’implique aucune aisance: deux frères, ou un père et ses fils, ont acquis à
force de sacrifices une barque à voiles de huit à douze mètres dont l’équipage est composé d’autres
parents, de voisins et d’amis. Plus petits que les bateaux de riches, ceux-ci oeuvrent dans un état d’impécuniosité
chronique. Les patrons doivent brader une partie de leurs captures afin que leurs fournisseurs les
Marc Larrarté
laissent repartir en mer. La rémunération des matelots consiste souvent en poissons dédaignés par les vendeuses
professionnelles, les arrain saltzale qui vont à pied jusqu’à Vera de Bidasoa vanter et vendre Ondarrabiko
arrain bizi-bizia. Dans ce contexte de précarité, les patrons n’ont guère la possibilité d’embaucher
un gamin qui ne soit pas de leur propre famille.
Voilà pourquoi les deux Larrarte, dans une épave de battela, renouent avec les gestes des anciens auxquels
les scientifiques ont rendu hommage en surnommant le cernier: Mérou des Basques. Et comme les
anciens, les deux gosses capturent de beaux et nombreux poissons.
1924. La bonne étoile de Jesús se nomme Rafael Aguirre. Ce réputé patron de Ciboure, dans la province
française du Labourd (Lapurdi), a commandé une txalupa handi de treize mètres, championne pour
les captures de sardine (Clupanodon pilchardus Walbaum). Il fonde de grands espoirs dans les sardiniers à
vapeur qui commencent d’exploiter un filet nouveau appelé bolinche (bolintxa).
Ciboure, petit port au débouché de l’Urdaxuri (La Nivelle) constitue avec Socoa, avec Hendaye, la cale
de Guethary et le hâvre de Biarritz, un potentiel halieutique basco-français ridicule comparé aux nombreux
et vastes ports du littoral espagnol. Microcosme qui n’en attaque pas moins une double révolution pour
laquelle, estime Rafael Aguirre, il va manquer de jeunes gens courageux et motivés par la pêche. Alors ce
patron avisé, sur le port de Fontarabie, demande aux uns et aux autres s’ils ne connaîtraient pas des adolescents
aficionados a la mar.
La double révolution en question concerne l’usage de la bolinche et la motorisation généralisée
des embarcations. En fait, le filet droit maillant, sare geldia, survit encore par sa rustique simplicité:
lorsque l’on a repéré des sardines aux abords du bateau (grâce à certaines montées de bulles, punpulloak,
ou à certains éclats dans la pâle clarté lunaire), le bateau met à l’eau un panneau de filet que
soutient kortxuko arlinga, la ralingue des lièges, et qui tombe verticalement sous la tension d’une ligne
de plombs, beruneko arlinga. De part et d’autre de cet écran, les matelots dispersent de la rogue,
mélange d’oeufs de morue et de tourteau d’arachide. La sardine se précipite goulûment et se prend
dans les mailles. La voilà captive. Il faut alors remonter le filet à bord, ce qui ne va pas sans peine. Le
démaillage du poisson s’effectue au port, procurant du travail à plusieurs kai gizon et kai emazte
(hommes ou femmes du quai), qui le distribuent dans des paniers ou des caissettes afin qu’il soit présenté
aux acheteurs.
Et là est bien le problème: le rustique sare gelgia ne sert qu’une fois par marée. Le progrès, c’est
bolintxa, la bolinche, un filet tournant, une senne, améliorée sinon inventée par les Ondarrabitar en
1917. Adoptée par les Cibouriens, elle a été très vite interdite par l’administration française: son efficacité
menacerait de détruire toutes les espèces pélagiques de la région. Quelques mois ont passé. Devant
l’insistance des pêcheurs, la même administration accorde, en 1922, une dérogation: la bolinche est
autorisée de la frontière espagnole à Vieux-Boucau, dans les Landes. Le résultat ne se fait pas attendre:
les sardiniers de Ciboure, qui avaient seulement capturé 847 tonnes en 1921, débarquent 2735 tonnes
en 1923.
Avec la bolinche, le pêcheur et le bateau sont plus actifs que dans le processus précédent. En présence
de sardine, repérée ou simplement devinée, deux matelots embarqués dans des plates minuscules dispersent
de la rogue pour la fixer et l’agglomérer. Tandis que les poissons se ruent sur ce festin, provoquant
un bouillonnement très visible, le sardinier parcourt un cercle en dévidant la bolinche, un piège tendu verticalement
entre une corde de lièges et une autre de plombs, et dont la partie inférieure se ferme à l’aide
d’une coulisse de chanvre, zerra, qui court dans une succession d’anneaux de bronze, erreztunak. Souquer
ce cordage et refermer le cylindre de mailles pour que les sardines ne s’échappent pas en plongeant
est une tâche, urgente et pénible, que les matelots accomplissent sans aide mécanique. Ils s’efforcent jusqu’à
ce que l’ensemble des anneaux et le fond de la poche soient halés à bord. La masse de poissons étant
alors captive, il reste à la distribuer dans des caissettes de bois, à l’aide d’une grande épuisette, salabarda.
L’avantage de la bolinche est qu’elle peut être remise à l’eau pour capturer un nouveau banc de sardines,
et encore un, etc...
Cette technique donne un coup de fouet à l’activité de pêche et de conserverie de Ciboure et Saint-
Jean-de-Luz. On parle de construire de nouvelles usines (elles passeront, en dix ans, de sept à dix-sept).
Des patrons, des usiniers, des particuliers se cotisent pour faire construire de nouveaux sardiniers. Il
devient urgent de recruter en Bretagne des femmes ayant l’expérience du travail posté, version française
de la taylorisation qui impose des tâches répétitives, tandis que les éléments du travail (sel, sardines,
boîtes, huile, cartons...) arrivent sur un tapis roulant. C’est dans cette effervescence que Rafael Aguirre
veut recruter et former un mousse qui pourra devenir un bon matelot et même un patron de pêche
compétent.
488
489
La première personne interrogée fabrique des hameçons sur le trottoir de la calle San Pedro.
– Si conozco uno? répond l’amu egile. Voyez: descendez jusqu’au puerto chico. Vous verrez un bachot
déglingué avec plus d’eau au-dedans qu’à l’extérieur. Demandez au sacripant qui sera là s’il s’appelle Krispín
ou Jesús. Celui-là sera votre homme.
Rafael Aguirre attend. Il apprécie l’accostage du gamin, qui a pêché une douzaine de zapateros, une
louvine de trois kilos et quelques autres poissons. Puis il l’accompagne à la ferme où vit officiellement
Jesús. Le Cibourien entreprend les tuteurs et la cause est entendue. Quelques jours plus tard, Krispín
Larrarte Lecuona passe en France pour apprendre le métier de marin-pêcheur, sous l’autorité et la responsabilité
du patron Aguirre, qui s’engage à lui procurer le gîte et le couvert.
Enrôlé en qualité de mousse, Jesús assimile avec ferveur. L’univers spartiate des hommes vigoureux et
rustiques qui composent les équipages de chaloupes et de petits moteurs lui plaît. De temps à autre, il lui
échoit certes un belarri ondoko, une baffe derrière l’oreille, parce qu’il a laissé échapper un cordage ou
renversé une caisse de sardines. Il n’en prend pas ombrage.
– C’est le métier qui rentre, commentent ses compagnons.
Il lui plaît tout autant, seul avec Rafael Aguirre à bord du Guynemer, de pêcher la langouste au casier,
le merlu (colin Merluccius merluccius) et le congre (Conger conger) à la ligne à main, et d’apprendre à connaître
les entrelacs de roches et les hauts-fonds du littoral basque. Il aspire maintenant à embarquer sur un
grand bateau et connaître la pêche au thon.
La pêche du thon, précisément du thon blanc Thunnus alalunga, appelé germon par les Français, est
en ce temps une merveille d’esthétique. Imaginez une txalupa noire de treize mètres avec ses deux mâts
dressés, arborant toute sa toile et courant au portant entre six et neuf noeuds dans la grande houle du
golfe de Biscaye (ou de Gascogne). De part et d’autre s’élèvent deux tangons qui écartent du sillage des
lignes de différentes longueurs. A la poupe, maniant la barre avec la majesté d’un dieu antique, le patron.
De ce tableau vivant, Kesus gardera du respect pour ceux qui se déplacent en mer sous l’impulsion du
vent, parmi lesquels se trouvera l’une de ses petites-filles, régatière acharnée. A certaine époque, il sera
quasiment le seul marin professionnel de Ciboure à créditer les plaisanciers, les voileux, de la même aficiòn
maritime que lui avait supposée Rafael Aguirre.
Désormais recherché par des bateaux à moteur, le thon est un adversaire qui mérite certains égards.
Les hameçons qui arment les lignes ne portent pas un appât, qui serait lavé ou même arraché par la vitesse,
mais un leurre, un simulacre de poisson constitué à partir de suikiñak, les enveloppes de l’épi de maïs.
Quelques artisans de Ciboure, Guéthary et Fontarabie se sont fait une spécialité de ces pseudo-feuilles (les
sépales de la fleur de maïs, en réalité). Ils les font sécher, ils les brossent, les décolorent en les plongeant
dans un bain de chlore, avant de les teindre de coloris violents et de les armer d’un hameçon de fort calibre.
Dans le sillage des bateaux, ces leurres sont particulièrement attractifs. Ainsi fonctionne ce que les
Guipuzcoans appellent curricàn.
La sardine avec la bolinche, le thon à la traîne, l’anchois (Engraulis encrassicholus) également avec le
filet tournant, parfois le merlu, le rousseau (Pagellus erythrinus), la louvine avec apailluak, des lignes de
fond appâtées et tenues directement à la main, tels sont les poissons qu’affronte Jesús Larrarte pendant
son temps de mousse. Les bateaux qu’il fréquente sont délibérément polyvalents: les patrons savent passer
d’une spécialité à l’autre, au gré des opportunités; ils souffrent donc moins que d’autres des méventes
qui accablent épisodiquement la profession.
Des manifestations sociales opposent, en 1924 et 26, les équipages de sardiniers à leurs propres armateurs,
qui sont aussi conserveurs, donc acheteurs de leurs poissons. Jesús observe avec circonspection. Le
plus virulent, le plus cynique des usiniers, Pascal Elissalt, enivre les matelots de ses bateaux, de bistrot en
bistrot, et leur commande ensuite de rejeter hors du port et même du Pays Basque les maudits marins Bretons
arrivés voici peu... à sa propre demande. Pourquoi cela? Parce qu’il y a solidarité entre tous ces Armoricains,
qu’ils soient venus faire la saison avec leurs propres bateaux (dont ils sont propriétaires) ou matelots
des barques basques depuis quelques saisons; parce qu’il sent se lever contre les dirigeants
quasi-esclavagistes dont il est l’archétype un grand vent de révolte.
Jesús et les hommes de sa génération commencent à comprendre combien ces gens du nord, co-armateurs
de leurs bateaux, sont en avance sur les arrantzale d’ici. Si quelqu’un sait accommoder à la mode
basque les acquis sociaux de ces étrangers, la pêche cibourienne cessera d’être un sempiternel sous-prolétariat
pour devenir une profession digne et rémunératrice. Bien sûr, cette prise de conscience ne s’est pas
faite sans aléas. Un grand syndicaliste parisien, Charles Tillon, s’est mêlé au conflit. Cela ne lui a pas porté
chance: il a perdu un oeil dans les échaufourrées. De cette époque, Jesús conservera une certaine
Marc Larrarté
défiance vis-à-vis des mots-d’ordre généraux et des mouvements de foule. Il pensera que l’amélioration de
la pêche doit venir du travail, de l’inventivité technique calmement débattue, de la solidarité, tout ceci axé
sur un humanisme du quotidien et préservé des idéologies. A son heure, et sans jamais claironner aucune
profession de foi, Krispín apparaîtra comme un patron social, préoccupé du sort de ses hommes. Mais il
s’étonnera toujours qu’on lui en fasse compliment.
Les quirats qui ont permis aux Bretons d’être propriétaires de leurs bateaux et de s’opposer sans crainte
d’être licenciés aux acheteurs de sardine, les quirats, donc, vont, dans les années 30, contribuer au
développement du port et à l’émancipation des pêcheurs.
Quirat, disons-nous. D’où vient ce terme que les Bretons utilisent abondamment? En France, l’usage
en est apparu au17e siècle, quand Colbert (le ministre de Louis XIV qui créa le système de solidarité maritime
encore en usage de nos jours, les Invalides de la Marine), encourageait les épargnants à miser sur des
bateaux de commerce. Mais qhirat, mot arabe, désignait, cinq siècles plus tôt, lorsque les Almoravides
étaient maîtres de l’Andalousie, les pièces de monnaie que des associés déposaient dans une jarre pour
financer les échanges et trafics envisagés. Reprenant le même principe, le quirat français permet à plusieurs
personnes d’entreprendre une oeuvre commune: construire, lancer et exploiter un bateau de commerce
ou de pêche.
Cette pratique de capitalisme populaire va revêtir à Ciboure un formalisme dépouillé. Les futurs associés
(par exemple: un patron, un mécanicien, deux matelots, un boulanger et le coiffeur de la bourgade)
se réunissent chez l’un d’eux ou, mieux encore, dans un café, territoire neutre. Ils commandent à boire.
Dès que le garçon s’éloigne, chacun exhibe une enveloppe dans laquelle il a glissé ses économies. Il la pose
sur la table en disant: – Je mets tant d’argent; – Moi, dit un autre, telle somme; etc... Quelqu’un fait le
compte du capital disponible. S’il suffit à entreprendre la construction du bateau envisagé, on désigne un
diruzain (trésorier, comptable), qui emportera tout l’argent dans un petit cartable, le gardera chez lui ou le
déposera dans une banque, comme il voudra, à condition de payer les sommes dûes à mesure de l’avancement
des travaux. Mais, si la somme est insuffisante, les personnes présentes cooptent quelqu’un d’autre
susceptible d’apporter le complément et d’être aussi quirataire. Pas de contrat écrit, on se serre la main
et ça suffit.
On peut s’étonner de ce que les armateurs des bateaux de pêche basco-français aient tardé à se servir
d’une forme aussi simple d’investissement. A leur décharge, il faut rappeler que la pêche a longtemps été
dans cette région l’affaire des pêcheurs, pauvres, sans un franc d’économies, ou de financiers soucieux de
rendements. Pas de moyen terme, pas d’autre intervenant. Ce sont les Bretons venus pour capturer la sardine
du golfe qui ont montré le rôle que pouvaient jouer les bas-de-laine et les cagnottes personnelles de
boutiquiers, de professeurs, d’ecclésiastiques ou de dentistes en s’ajoutant aux économies des gens de
mer eux-mêmes. Si muchos pocos hacen un mucho, si les petits ruisseaux font les grandes rivières, les
pêcheurs basques viennent enfin de découvrir le moyen de s’offrir des bateaux modernes et sûrs.
Nous sommes en 1931. Novice après avoir été mousse, Krispín Larrarte termine son apprentissage. Il
est prêt à passer matelot. Il est engagé par Dominique Echeverria (surnommé Xudur motza, nez court, un
490
1931. Chaloupe à
moteur L’Etoile dont le
novice est Jesús Larrarte,
appareillant de Ciboure.
Au fond, à quai, un
vapeur de l’armement
Plisson.
491
adversaire lui ayant croqué cet appendice au cours d’une rixe), qui constitue un nouvel armement avec
quatre associés. Cette équipe va exploiter un bateau révolutionnaire construit par Nañi Hiribarren à Socoa,
une pinasse de forme classique, à cul de trainière, de douze mètres mais propulsée par un moteur Couach
de douze chevaux... à essence. Cette option surprend le milieu maritime cibourien, certes converti à la
mécanique depuis que la famille Letamendia lança, en 1886, une barque performante: Les Trois Frères,
mais persuadé que la machine à vapeur représente la perfection en ce domaine. Ce moteur thermique,
dit-on, va être bruyant, malodorant, générateur de vibrations, difficile à refroidir. Et puis, est-il bien raisonnable
de naviguer avec un hectolitre d’essence explosive sous les pieds?
En dépit de ces interrogations et de ces doutes, L’Etoile, durant quatorze mois, se consacre aux pêches
de surface (dites aussi pêches des pélagiques ou captures de poissons bleus) que pratique la majorité des
grandes unités du port, thon, sardine, anchois. De temps à autre, elle va tenter le merlu et le pageot au
Gouf de Capbreton, tout près d’ici. Au terme de quoi, les associés peuvent dresser un bilan: L’Etoile est un
bon bateau mais, un peu trop petit et trop léger, il passe plus de temps qu’il n’est raisonnable en allers et
retours entre le port et les pêcheries.
Pour pallier ce défaut, les quirataires, qui comprennent maintenant Jesùs Larrarte et trois matelots
supplémentaires (Bernard Manterola, dit Tomás, Albert Duzer et Henri Larreguy) passent commande d’un
bateau neuf à Nañi Hiribarren. Ce sera L’Etoile II, dix-sept mètres, moteur Bolinders de deux cylindres et
cinquante chevaux, à essence, une fois encore.
Devant le succès de cet armement, plusieurs patrons de Ciboure, parmi lesquels le réputé Pascal
Zugasti, dit Pistolett’, adoptent des options comparables. Commence une ère d’émulation, d’essais, d’inventivité
curieuse, comme si, enfin propriétaires de matériels efficaces, les marins se sentaient un peu
fous, légèrement euphoriques, moins préoccupés de thésauriser que de risquer et de découvrir.
Un jour de 1933, Albert Duzer repère dans le magasin bayonnais d’accastillage Sorin une cuiller ondulante
américaine Record utilisée par les pêcheurs sportifs d’espadons, laquelle présente la forme et les
dimensions d’une banane. Quelques jours plus tard, avec cet engin traîné par quarante mètres d’un briña
de chanvre prolongé par deux mètres de laiton, Krispín croche un thon rouge de trois-cents kilos à trente
milles dans le nord de Lekeitio. Après une demi-heure de lutte acharnée, freinant les sursauts, reprenant,
tout ceci sans moulinet, évidemment, les doigts sciés en dépit des biraba (doigtiers) de feutrine, il amène
à contrebord le monstre que ses compagnons peuvent gaffer et embarquer. Dès cet instant, Jesús estime
que le traditionnel peita à base de suikiña de maïs va tomber en désuétude. Mais il se trompe: pendant
plusieurs années, les tenants de l’un et l’autre artifices vont alterner les bons résultats.
Albert Duzer partage, lui, la conviction de son jeune équipier. Il retourne chez Sorin pour acheter toutes
les cuillers Record disponibles. Mais le vendeur, astucieux, en conserve une et la propose, moyennant
un prix exorbitant, à un Ondarrabitar nommé Segurola, qui fait confectionner des imitations aussi efficaces
que l’originale par différents artisans du port guipuzcoan.
1931. L’équipage de
L’Etoile II. Au fond à
droite, Jesús Larrarte
Marc Larrarté
Le scénario inverse se déroule peu après avec une cuiller carrée, concave, large comme une main, brillante,
conçue par les Ondarrabitar, et copiée par les Cibouriens. Cet engin, on ne le traîne pas dans le sillage, on
l’arme quand le thon rôde autour du bateau en dérive: on le jette à l’eau, il plonge et tournoie, on le reprend,
on le relâche, et ainsi de suite jusqu’à ce que le cimarròn excité morde et que commence la bagarre.
Les bonnes captures de L’Etoile se répètent et se renouvellent: une fois cent petits thons rouges de dix
kilos; une autre fois, deux ou trois pottolo de cent kilos et plus; ou encore cent-cinquante kilos de thon
blanc hegal luzea...
Au cours de ces années 1930, les pêcheurs changent de bateau comme de chemise. Ils vendent des
embarcations tout juste rodées pour en acheter ou mettre en chantier de plus performantes. Ainsi le
matelot Jesús se retrouve bientôt co-armateur du sardinier Marianne de dix-sept mètres et moteur (diésel,
cette fois) de quatre-vingt chevaux.
La guerre civile espagnole amène sur la côte basque française de nombreux réfugiés, parmi lesquels
des pêcheurs de Biscaye et Guipuzcoa, mais aussi de Cantabria, des Asturies et de la Galice, ceux-ci étant,
en dépit de la péjoration attachée à leur origine (quítate de ahí, Gallego! veut dire: ne touche à rien, maladroit,
tu vas tout démantibuler!) des marins particulièrement efficaces.
Curieusement, les frères de Jesús (Anastasio, Juanito et Bixente, celui-ci promis à une mort terrible à
l’âge de vingt-et-un ans, victime d’un tétanos provoqué par une piqûre de rascasse) ne manifestent aucune
envie de s’installer en France:
– Nous avons ici notre famille et nos amis, disent-ils. Certes, nous ne vivons pas au paradis, mais notre
heure viendra, comme viendra le moment où ce pays aura besoin de la compétence de tous ses fils pour
se développer.
Jesús vient d’obtenir la nationalité française (il s’appelle désormais Jésus Larrarté, avec des accents sur
les É, mais on dira toujours Jesús, voire Kesús – diéchouch’ ou kéchouch’ –) quand débute la deuxième
guerre mondiale. Il est immédiatement mobilisé en compagnie de son ami cibourien Maiz egarri (souvent
assoiffé, tel est son surnom) et plusieurs autres. Avec le navire de transport El Mansour (le victorieux, en
arabe; admirons l’ironie de ce nom, à la veille d’un écrasement des armées françaises), il dépose et embarque
des troupes à Glasgow et Greenok, Ecosse, comme à Dakar, Sénégal où il passe quelques mois, cuisinier
à la base aéro-navale de Bel Air.
Démobilisé, il revient à Ciboure. Il épouse Mercedes, fille de Bentxan Cerciat, mécanicien de la belle
pinasse Marie-Rose que construisit en 1934 Nañi Hiribarren de Socoa pour les pilotes de Saint-Jean-de-
Luz, et de Marianne Ochoteco, arrain saltzale, vendeuse de poisson qui, dans sa jeunesse, allait à pied jusqu’à
Sare, à vingt kilomètres par le col de Saint Ignace, vantant les qualités du thon pêché à Ciboure, un
thon dont le sang coulait sur son visage et sa poitrine puisque, à l’instar de ses compagnes, Marianne
transportait sa marchandise dans un couffin en équilibre sur sa tête. Mercedes Cerciat est filetière du
Lohitzun, un sardinier appartenant à l’armateur Fargeot de Saint-Jean-de-Luz. Anecdote: elle est née le 18
septembre 1921, dans la belle maison flamande de Ciboure (Estebania) où naquit, quarante-six ans avant
elle, le compositeur Maurice Ravel, auteur de l’archi-célèbre Boléro.
492
1940. Mercedes Cerciat,
future épouse de Jesús
Larrarte, à gauche, et
son amie Lolita Zugasti,
fille du célèbre patron
Pascal Pistolett, ramendant
un filet dans l’atelier
de M. Fargeot, armateur
du sardinier
Lohitzun.
493
Krispín s’imaginait renouer avec son équipage et reprendre la pêche. Mais non. Les occupants allemands
réquisitionnent son bateau qu’ils arment d’un canon contre les patrouilleurs anglais. La situation
est dramatiquement simple: – la pêche en haute mer est interdite; – la pêche côtière est autorisée, assortie
d’énormes sujétions et contraintes; – les rares bateaux de plus de dix mètres qui, parce que vétustes et
lents, n’ont pas été réquisitionnés, pourront pêcher la sardine dans une bande côtière d’un mille et demi;
mais leurs captures seront achetées, à un prix qu’ils décideront eux-mêmes, par les intendants allemands.
Résolu à ne pas travailler pour le roi de Prusse, Jesús arme son batteliku de cinq mètres, simplement
appelé Jesús, ce qui lui apporte un avantage imprévu. Les Allemands ont tendu des câbles et des chaînes
entre les quais et les estacades du port. Ce piège ne s’ouvre que le matin, sous la surveillance de soldats
chargés de noter les canots qui prétendent sortir. Chaque patron-sans-équipage, comme disent avec
amertume les pêcheurs, crie le nom de son embarcation. Le vert-de-gris note et le marin peut appareiller.
Mais l’Allemand ne comprend pas toujours des noms compliqués comme Maiatzeko lorea, Primaderako
lorea, Egarri gabe sekulan (Fleur de Mai, Fleur de printemps, Jamais altéré). Il demande au marin de répéter,
il exige de voir l’inscription portée sur la coque, tout cela fait perdre du temps. Pour Krispín, c’est plus
simple: il clame Iééézouss! deux ou trois fois. Le soldat finit par entendre, il confirme: Iééézouss! et il
accorde l’exeat tant espéré. Chaque bateau doit être rentré avant que le soleil soit couché. Un soir, un sardinier
retardataire tente de forcer le passage. Il se prend dans un câble métallique et chavire. Ainsi meurt
un mousse de quinze ans.
Le 6 juin 1944, les troupes alliées prennent pied sur le sol de Normandie. La libération du territoire
français, la Libération avec L majuscule, commence. Le 22 août, les Allemands évacuent Ciboure. Une
cérémonie ridicule, organisée par quelques imbéciles qui faisaient dans leurs culottes et se prétendent tout
à coup Résistants de la première heure, finit d’écoeurer les arrantzale. Tournant le dos à ces Tartuffes, ils
retournent à leur domaine. En mer, le courage et la ténacité ne se maquillent pas.
Ce que l’on appelle alors dommages de guerre (il s’agit en réalité de leurs compensations; les dommages,
ce sont les dégâts provoqués par les Allemands) pour une part, et les quirats déjà évoqués d’autre
part, vont accélérer la recontruction de la flotte et le nouveau développement de la pêche basco-française.
Ceux-ci, les quirats, prennent alors trois formes principales: 1°– plusieurs marins et personnes du voisinage
réunissent des économies sensiblement égales et se partagent la propriété du bateau; 2°– deux,
trois, quatre marins ou plus s’associent à un important investisseur terrien (un conserveur, un commerçant,
un fonctionnaire...), la coutume voulant que les gens de mer demeurent majoritaires dans le capital; 3°–
suivant un protocole très strict, comparable au processus de portage utilisé dans les petites et moyennes
entreprises d’aujourd’hui, un investisseur riche (aberatsa, disent les Cibouriens) achète et paie entièrement
le bateau; ensuite, les quirataires marins lui remboursent peu à peu leurs quote-parts. Le riche peut rester
associé minoritaire ou solder ses parts et contribuer à financer la construction d’un nouveau bateau avec
d’autres personnels navigants.
Une parenthèse qui nous projette dans l’avenir: Georges Olascuaga, qui bénéficie d’un tel portage
pour l’acquisition de son thonier Sainte Thérèse s’en souviendra dans les années 1980, après qu’il aura
pris sa retraite; pour relancer une flottille vieillissante, il reprendra ce principe; mais une coopérative de
marins fondée par lui, Hegokoa, jouera le rôle de porteur naguère tenu par des riches, pour soutenir les
jeunes patrons candidats à la fonction d’armateur. Il faudra un jour consacrer à ce pêcheur modeste la biographie
qu’il mérite.
La reconstruction du potentiel de pêche étant une nécessité vitale, le contexte fiscal et social de l’époque
est très incitatif. Le Ministère des Finances ignore de manière délibérée les véritables bénéfices des
pêcheurs. Pour imposer ceux-ci, il considère seulement des rémunérations théoriques, établies chaque
année par l’administration pour le calcul des retraites et des prestations-maladie: les salaires forfaitaires. A
revenus comparables, les pêcheurs paient donc des impôts moins élevés que les ouvriers d’usine, les fonctionnaires
ou les agriculteurs. L’argent qu’ils ne versent pas à l’Etat, ils peuvent l’investir dans leurs bateaux.
Mettant à profit ces facilités, Kesús Larrarté commande un sardinier de 17 mètres, Jean Claude, avec
dix associés identifiés comme Palli et compagnie. Retenons cette formule typiquement basque: lorsque
l’on s’approche d’un groupe qui discute, on identifie l’un de ses membres (supposons: Palli, le père d’un
futur champion de golf) et l’on déclare à voix haute: – Agur! Palli ta konpañia. Chaque membre de l’assemblée
se considère alors salué personnellement avec tous les égards qui lui sont dûs.
En 1948, Pantaleón Izarraga, dit Gatu arraña, associé de l’ex-constructeur naval Vincent Letamendia
dans l’exploitation du Bidassoa, un sardinier lancé en 1929 par Nañi Hiribarren de Socoa, cesse son activité
professionnelle et prend ses Invalides. Le mécanicien Sébastien Retegui et Krispín rachètent aussitôt ses
parts et celles de ses proches.
Marc Larrarté
Le Bidassoa, bien qu’il ne mesure que dix-sept mètres et ne développe que170 chevaux, sera un bateau
de haute mer. Ses campagnes le conduiront au loin, jusqu’en Galice et en Bretagne, dans une activité
que l’on commence à considérer comme une chasse, un safari au thon blanc hegal luzea. Mais ses
succès les plus notables impliqueront la pêche sardinière et son humanisation grâce au véritable climat
familial qui régnera à bord. En 1949, pour expliquer comment ses hommes conservaient force et bonne
humeur en dépit d’un travail pénible, Kesús confiera ceci:
« – Nous sommes une sorte de famille. Tiens, le repas, par exemple. Assez souvent, sa préparation justifie
un acte de pêche particulier, un entracte, une récréation, pour mieux dire. Le coq (le cuisinier) décide
que l’on ne puisera pas dans les vivres fournis par l’avitailleur Pontaut de Ciboure. On ne va pas non plus
manger ce qu’ont préparé les maîtresses de maison, tu sais, ce que nous apportons dans des pottera
émaillés entourés d’une serviette et accompagnés d’un demi-pain, une bouteille de vin, un morceau de
fromage et deux fruits, tout cela contenu dans otarrea, le panier en lames de chataignier de chaque matelot.
Non, nous allons manger du poisson frais. Le bateau fait donc un détour vers une basse (un haut-fond)
appelé Mendi Azpia, devant la falaise de Bidart. Et les hommes mouillent des lignes à kraba.
– Des crabes? Vous pêchez des crustacés avec des lignes et des hameçons? s’étonne le questionneur,
confondant le mot basque kraba avec le terme français crabe.
– Ezetz, haurra! Les crabes se disent xamar ou txangurro. Nos kraba (Serranellus cabrilla) sont des poissons
de roche de la famille des Serranidés, une variété de mérou, si tu préfères, mais de petite taille.
– Ah, d’accord. Et alors?
– Quand le coq estime que nous avons assez pêché, il allume son fourneau et le bateau reprend sa
campagne.»
A cette époque, le cuisinier du Bidassoa est un jeune Cibourien surnommé Blanc-blanc à cause de son
teint noiraud. Sa tache n’est pas bien commode (la cuisine est un réduit vraiment éxigu derrière la passerelle
de navigation) mais il ne se plaint jamais et demeure au contraire toujours prêt à plaisanter.
«– Fonds d’huile, poisson tronçonné, bouillon aux herbes, pain et patates constituent les ingrédients
du jour. A juste cuisson, le coq touille une dernière fois et pose le tupiña au milieu du pont, sur le capot de
la cale ou la sole d’une plate retournée. Et chacun vient se servir. On appelle ça: manger baltxan, en puisant
dans le pot commun. Chacun, en commençant par le patron, en finissant par le mousse, prend la place
de son choix puis pioche avec la cuiller de service pour garnir son guignon de gros pain évidé ou son
écuelle. Une fois la cuiller plongée dans le pot, il faut l’amener vers soi, puiser dans sa propre direction,
sans choisir, sans regarder. Tant pis si l’on tombe sur un avorton farci d’arêtes alors que l’on a pêché et
fourni un beau kraba charnu. Celui qui enfreint ce code reçoit du patron un bon coup de manche de couteau
sur les phalanges.
Je ne sais pas si cet usage va perdurer, conclut Jesús. Certains de mes collègues estiment que l’on passe
trop de temps à ce divertissement. Si cette habitude disparaît, ce sera dommage. Et l’on mangera
davantage de viande à bord, probablement. Car, c’est bien connu, un pêcheur n’achète pas facilement du
poisson. Il le capture lui-même ou il consomme autre chose.»
La sardine s’apprête à jouer un mauvais tour aux pêcheurs de Ciboure. Très logiquement, puisque peu
pêchée pendant l’Occupation, elle a abondé à la Libération. Les marins se sont empressés de reconstituer
la flotte détruite, les usiniers ont relancé leurs chaînes, les femmes de la bourgade ont repris le chemin du
travail à l’appel des sirènes annonçant d’importants arrivages. Le port est à la veille de supplanter Douarnenez
pour le titre, honorifique, certes, mais révélateur d’une économie gaillarde, de premier port sardinier
de France. Les pêcheurs harcèlent les pouvoirs publics pour que soient entrepris des travaux et construits
des équipements correspondant à cette situation: une criée moderne, une station de mazout digne
de ce nom, une fabrique de glace en paillettes, un pesage moderne. Les plus optimistes parlent d’agrandir
le port en déplaçant le pont routier, de planter des grues et des lampadaires, d’acheter des chariots
métalliques pour transborder les caisses, d’installer des plateformes de levage, des rouleaux pour le débarquement
des filets... tous travaux qui seront entrepris dans dix ans!
C’est le moment précis où le petit Clupéidé d’argent se raréfie. Les 3700 tonnes annuelles, peu ou
prou, des premières années de liberté tombent soudainement. Les captures de 1950 résonnent comme un
glas: 375 tonnes! La folle joie, les espoirs, la volonté de reconstruire un monde juste et prospère semblent
compromis. Les professionnels s’interrogent, ils harcèlent les scientifiques de l’Office des Pêches (Office,
plus tard Institut Scientifique et Technique des Pêches Maritimes, aujourd’hui IFREMER). Jesús et certains
patrons émettent qu’ils ont été trop gourmands, que les pêcheurs, et lui-même le tout premier, auraient
494
495
dû gérer la production de ce bout d’océan qu’ils désignent comme golkoa, le giron, ou plus fréquemment
encore comme baratzea, le jardin. D’autres pensent que la mer est tellement vaste qu’elle en est inépuisable,
que la cause est ailleurs.
Habitués à miser sur plusieurs tableaux, les conserveurs de Ciboure commencent d’installer des succursales
au Maroc, à Safi et Agadir, de manière à pouvoir fournir leur clientèle même si la dégradation persiste.
Une grande incertitude règne, du moins tant que dure l’hiver, saison de la sardine locale. Car le printemps
ramène, lui d’autres projets, et ceux-là sont franchement exaltants.
Voici près d’un an, deux personnalités de la ville ont invité certains patrons-pêcheurs supposés particulièrement
influents au Sélect, l’un des quatre cinémas de Saint-Jean-de-Luz, pour une séance un peu particulière.
«– Il s’agissait d’Albert Elissalt, évoquera Krispín, le fils du conserveur qu’avaient défié les grévistes bretons
de 1926, et de son beau-frère Gaston Pommereau, dirigeant d’une autre conserverie (les Entreprises
Maritimes Basques, installées à Socoa), des personnalités très sérieuses, compétentes. Nous avons été
d’autant plus étonnés par le film qu’ils nous ont montré: une plaisanterie, une galéjade. Nous voyions des
types propres et élégants comme des touristes, shorts, chemisettes, casquettes de toile, agiter des cannes
à pêche de deux à trois mètres et arracher à la mer, sans effort apparent, des dizaines de thons, à une
vitesse folle. Nous étions tous pliés de rire: quels grands enfants, ces Américains! Mais pour la réalisation,
chapeau! c’étaient les rois du trucage.»
Les patrons de pêche se trompaient. Il n’y avait aucune tromperie. On venait de leur montrer une réalité
qui allait bouleverser leur existence: la pêche du thon à l’appât vivant.
«– C’est une pêche en deux temps, devait leur expliquer Albert Elissalt. D’abord, le bateau doit s’emparer
de sardines, d’anchois ou de chinchards (Trachurus trachurus), tout à fait classiquement, à l’aide du filet bolinche.
Ce poisson, au lieu de le mettre en caisses pour le vendre, on va s’efforcer de le conserver vivant, dans des
réservoirs peints en blanc et abondamment oxygénés. Ensuite, ce peita (puisque l’on va reprendre pour cet
appât le nom des leurres en paille de maïs) on va le proposer au thon. Ce qui est plus facile à dire qu’à faire.»
On connaît une dizaine d’espèces de thonidés. Celles que Kesús et ses hommes ont déjà pêchées se
nomment Thunnus thynnus, le thon rouge qui peut atteindre des tailles et poids importants, et Thunnus
alalunga, le thon blanc germon aux nageoires latérales en faucille (hegal luzeak). Plus tard, les pêcheurs de
Ciboure captureront sous les tropiques le Thunnus obesus, patudo ou begi handi, le Thunnus albacares à
nageoires jaunes et le Katsuwonus pelamis, listao ou skipjack.
Tous ces animaux ont des caractéristiques communes qui vont permettre aux Basques de les capturer:
– ils sont migrateurs, ce qui revient à dire qu’ils empruntent les mêmes routes à intervalles réguliers; – ils
sont organisés et même hiérarchisés en bancs; – ils se déplacent en surface durant la journée; – au petit
matin, affamés, ils attaquent à grand bruit les bancs de sardines qui, par ailleurs, sont harcelés par les oiseaux
de mer.
Voilà, le décor est planté. L’action peut commencer. Nous sommes en mer. Le bateau fait route. Juchés
sur ses parties élevées, mâture et toit de la passerelle, les matelots observent les oiseaux et l’état de la mer.
Des plongeons répétés indiquent soudain la présence de poissonnets acculés à la surface par de gros prédateurs
qui les attaquent par-dessous. Mais il y a d’autres signes. C’est peut être une nappe huileuse qui
dépare une mer par ailleurs clapoteuse. On appelle cela leguna: les thons repus se reposent sous leurs
déjections huileuses. Ailleurs, au contraire, un crépitement, un bouillonnement perturbe la surface: balbaia
ou sardara, dû à la présence de thons pris de frénésie. Ces manifestations échappent généralement à
l’oeil d’un néophyte; pas à celui d’un pêcheur d’ici.
Le bateau se laisse dériver sur le banc. Il a branché de fins jets d’eau qui vont brouiller la surface, empêcher
les thons de deviner le danger, et simuler le frétillement de poissonnets pris de panique. Cependant,
à bord, le peitero distribue à ses compagnons des poignées de peita tirées d’un vivier. Et, à l’aide d’une
épuisette, il en balance des rafales vers le banc de thons, que tangente maintenant le bateau.
Dans la coursive tribord, les hommes ont empoigné de fortes cannes de bambou. Pas de moulinet,
bien sûr, un simple gut bien costaud et un gros hameçon que l’on passe sans état d’âme dans le ventre
d’un anchois, d’une sardine, d’un chinchard, et que l’on met à l’eau.
On n’a pas longtemps à attendre. Un thon a mordu à cet appât-là, comme il aurait mordu à l’un de
ceux que balance le peitero. Le marin crie: – Tenk!, relève sa canne et attire le thon le long du bord. L’un
de ses camarades s’approche avec un croc à long manche (krokua, gantxoa), gaffe la bête et l’amène prestement
sur le pont. Puis il retourne assister le prochain copain qui criera: – Tenk !
Marc Larrarté
Ici, là, d’autres thons ont mordu. L’action s’accélère. Bientôt les poissons, saisis de frénésie, happent
même les hameçons nus. Les matelots travaillent avec précision, sans précipitation, calmement et vite. Pas
un geste de trop. Pas un mot, si ce n’est sous l’effort ou l’exaltation. La coordination est parfaite entre
ceux qui relèvent les cannes, ceux qui gaffent et remisent les poissons. Et puis, pour une raison mystérieuse,
ça ne mord plus, tout s’arrête en quelques instants. Les thons qui nagent encore sondent et disparaissent
en profondeur. Une ou deux tonnes de leurs congénères ont été capturées. Le pont est poissé d’un
sang noir et corrosif. Entre les claies qui compartimentent l’arrière du bâtiment crépitent des coups de
queues désespérés. Les matelots achèvent ces survivants à coups de matapitx, des gourdins à poignées
ergonomiques qu’ils ont sculptées pendant les heures de route. Ils ne font pas ça par sensiblerie mais par
intérêt: un thon dont l’agonie se prolonge sécrète de l’histamine, une toxine qui abîme sa chair et lui donne
un goût désagréable.
Bien sûr, on n’en est pas là quand les patrons de pêche se quittent après la projection et les explications
des deux usiniers. Mais, tout de même, l’idée va son chemin. Plus d’un marin se souvient alors du dépit
qu’il éprouve quand, pêchant à la ligne de traîne, il prélève seulement quelques thons dans un banc pourtant
copieux. Ici, c’est un autre rendement! D’autres se rappellent aussi que, lorsqu’ils ont amené un petit
banc d’anchois le long de la coque, ils ont vu tournoyer des thons autour du filet, et sont même parvenus
à les pêcher alezian, c’est l’expression consacrée. En somme, les pêcheurs basques ne sont surpris qu’à
demi. C’est le côté organisé de la pêche américaine et son apparente facilité qui les ont troublés. Mais,
attirer le thon avec des poissonnets vivants, ils connaissent déjà.
En homme qui adapte ses actes à ses convictions, Pascal Elissalt équipe sa pinasse Marie Elisabeth pour
ce nouveau métier. Il la dote, notamment, d’une inesthétique protubérance au milieu du pont avant: un
vivier de bois destiné à préserver l’appât. Quelques patrons font comme lui. Très vite, ils comprennent que
le film américain n’a pas tout montré. Il reste beaucoup à apprendre. Mais les Cibouriens s’y mettent vite.
Le poissonnet conservé dans le vivier meurt très vite: on en met moins, on fait circuler de l’eau fraîche, on
peint les parois en blanc, et ainsi de suite. Chaque problème suscite une réponse rapide chez ces hommes
que l’aventure émoustille.
Une saison encore, Kesús et son associé le mécano Sébastien pêchent à la ligne de traîne. Et puis, ils
font comme tous leurs camarades. C’est ainsi qu’à son tour Bidassoa est alourdi d’un gros vivier de bois
qui donne à cette coque élégante un vague air de château médiéval. Et l’on pêche. Deux étés ont suffi: la
live bait fishing des pêcheurs californiens a été adoptée, adaptée et maîtrisée par les pêcheurs basques de
Saint-Jean et Ciboure, comme elle va l’être par ceux de Fontarabie, Pasajes, Guetaria et Lekeitio, qui sont
leurs amis et souvent leurs parents.
La sardine était un poisson populaire, pratique (salée, séchée, mise en boîte), relativement bon marché,
qui trouvait son débouché auprès des ménages et des armées en campagne. Le thon est un mets plus raf-
496
1950. Le thonier
Bidassoa de 1929,
après sa transformation
pour la pêche à
l’appât vivant. La
grosse caisse inesthétique
sur le pont
avant est un vivier.
497
finé, que la mise en conserve va permettre de figurer à la table de gens modestes. Un énorme marché
s’ouvre aux pêcheurs du Pays Basque. Alors, pour le pêcher, ce poisson-roi qui promet une vie moins aléatoire,
et qui fera même quelques fortunes, on s’équipe.
Les infrastructures portuaires? Elle serviront à cette nouvelle espèce, il suffira de les adapter. Les bateaux?
Ils vont s’agrandir, se moderniser, s’équiper de cuisines dignes de ce nom, d’un carré, et même de
douches et de cabinets! Mais, pour l’essentiel, il seront dotés de grands et gros viviers, d’une cale à glace
de plusieurs mètres cubes, de moteurs puissants et endurants. Car le thon, on le pêchera parfois derrière
l’Artha, la digue majestueuse qui protège la baie de Saint-Jean-de-Luz, mais il faudra aussi le pourchasser
pendant des jours et des jours à plusieurs dizaines de milles du port.
Quatre années passent. Le port basque évince largement Groix, Yeu, Etel, jusqu’ici réputés pour leurs
captures thonières, et qui viennent à peine de renoncer à leurs vieux dundees à voiles. Et ce n’est qu’un
début. Les patrons de pêche rivalisent de savoir-faire. Cela n’a rien d’étonnant: ils vivent quasiment les uns
sur les autres. Ce que sait ou fait l’un, les autres l’apprennent et le reproduisent bien vite. Il en est un, tout
de même, qui se distingue de la troupe. C’est un ami et un voisin de Kesús, un grand istrak au visage
moqueur ombré par un béret pointé de l’avant, à la manière d’une casquette de voyou: Bégnat Josié. Dans
la rue, les Cibouriens râblés et courtauds comme Krispín ou Antton Itoiz, les gros baraqués comme Arbide
ou Koxé-Mari Salha se dandinent et vont au roulis. Bégnat, lui, avance d’un pas d’échassier nonchalant,
avec une sorte de tangage. D’un mouvement d’épaule, de temps à autre, il équilibre un otarre qui pend à
la saignée de son bras.
Avec le Roi du Jour, une chaloupe à moteur de dix-sept mètres, il a, comme tous les autres, pêché le
thon à la ligne de traîne. C’était un bon patron. Il montrait du flair et une grande science de l’eau. Puis il
a manifesté un intérêt discret pour la pêche à l’appât vivant. Il ne s’est pas jeté comme un fou sur cette
nouveauté. Il sentait qu’il y aurait une période d’ajustement. Il s’est lancé avec la deuxième vague. Très
vite, il a maîtrisé cette méthode. C’est simple: il voit tout, tout de suite, avant tout le monde. Il a analysé
la situation et donné l’ordre de pêche quand les autres patrons s’interrogent encore. Il sent même, d’une
manière qu’il ne veut ou ne peut expliquer, dans quel secteur d’une mer apparemment uniforme apparaîtront
les indices. Il s’y rend, il observe, il pêche. Les thons et lui sont de connivence, prétendent certains
patrons de Fontarabie: – El tío Beñat lleva citas con el bonito, hasta se lo va ligando ou encore: Gizon tzar
hori baik egalak.
A Ciboure, on prétend simplement que Bégnat ne se noiera jamais. Il est tellement surveillé que, s’il venait
à faire naufrage, il serait repêché sans attendre. C’est désormais un nouveau bateau que les observateurs devront
suivre: le Bégnat de dix-huit mètres, tout récemment sorti du chantier Grégoire Marin de Ciboure.
Dans l’ordre désormais pressé des constructions neuves, c’est Krispín Larrarté qui aurait dû inaugurer
son bateau. Mais la difficulté de trouver une longue pièce de quille pour le futur Bidassoa II a retardé la
mise en chantier. Finalement, Vincent Letamendia a prié son ami Monsieur de Coral, propriétaire du château
historique d’Urtubie à Urrugne (château d’où partirent, à la fin du 16e siècle, les rumeurs de sorcellerie
qui allaient faire juger et brûler plus de six cents personnes dans la contrée) d’abattre l’un des chênes
multicentenaires de son parc. Encore le fût ne mesure-t-il pas les quatorze mètres requis, et les frères Hiribarren
devront-ils assembler la quille en deux parties.
Dans le petit bureau de leur chantier sont réunis les frères Hiribarren, fils du célèbre Nañi et, comme
lui, charpentiers de marine, ainsi que Vincent Letamendia, Sébastien Retegui et Jesús Larrarté. Ces trois
derniers viennent de passer commande d’un sardinier-thonier de dix-huit mètres de forme traditionnelle à
cul de trainière. Letamendia, ingénieur civil, ancien constructeur naval lui-même, est chargé de suivre l’évolution
du travail. Pendant ce temps, Sébastien et Jesús continueront de naviguer avec le Bidassoa. Avec
succès, puisque la vieille barque de 1929 manquera de chavirer sous le poids de ses dernières captures.
Avant toute chose, Vincent Hiribarren va façonner une demi-coque réduite. Il ne travaillera pas sur
plans, mais en adaptant les indications et les exigences de l’armement à sa déjà longue expérience. Il devra
notamment faire en sorte que la coque puisse contenir quatre viviers de vingt-deux mètres cubes pour
la conservation de l’appât, désormais nécessaire à la capture du thon.
Cette maquette sera sculptée au couteau dans un bloc de sapin. Un bloc, ce n’est pas le terme exact:
il s’agira d’une juxtaposition de planchettes épaisses d’un centimètre solidarisées par des chevilles. Pourquoi
des tranches de bois? peut-on se demander. Pour pouvoir en disposer séparément. Ce sera commode
pour en agrandir les contours à l’échelle. On obtiendra facilement les profils du vrai navire. La découpe
de chaque tranche correspondra à une section du bateau réel, traditionnellement large de quatre-vingts
centimètres. La demi-coque sera donc à l’échelle 1/80.
Marc Larrarté
La maquette est achevée en quelques heures. Letamendia s’en déclare enchanté. Hiribarren disjoint le
bloc de bois. Il dispose maintenant d’une série de profils grâce auxquels, par projections homothétiques,
lui et ses frères tracent des gabarits à la taille réelle... en double exemplaire, car s’ils partent d’une demicoque,
c’est évidemment un bateau entier qu’il leur faut construire. Ils corrigent les petto qui résultent de
malencontreux coups d’instrument, peu visibles sur une maquette de vingt à vingt-cinq centimètres mais
qui, en vraie grandeur, sautent aux yeux. Quelques traits de rabot suffisent. Letamendia donne son avis:
les formes suggérées par les gabarits correspondent bien au bateau que ses associés et lui souhaitent
exploiter. La construction va pouvoir commencer.
Sur des cales soigneusement nivelées, les charpentiers ajustent la quille, l’étrave et l’étambot, pièces
réelles et définitives du navire qui sont en chêne, un bois serré qui ne pourrit pas. Puis ils disposent les
gabarits comme une gigantesque cage thoracique. Sur le chantier s’élève bientôt un simulacre de bateau,
un mannequin dont les éphémères côtes sont en bois disparates récupérés lors de précédentes constructions.
Cette pré-carcasse est ensuite bordée. Autrement dit, les charpentiers constituent ce qui sera la coque
du navire. Il y a deux manières de procéder. S’ils bordent à tapisser, ils réalisent l’enveloppe entière avec de
l’iroko ou de l’acajou, des bois qui ne travaillent pas. Si, comme pour Bidassoa, ils bordent à virure passée,
ils posent une lame sur deux. Ils utilisent du chêne qui va travailler et finir de sécher pendant la construction.
La coque ajourée ainsi obtenue sera terminée le plus tard possible.
Un observateur pourrait s’étonner: il pousse des millions de pins dans le département des Landes,
tout à côté; pourquoi ne s’en sert-on pas? Hiribarren reconnait à ce bois d’incontestables qualités mécaniques,
un faible coût et... un défaut rédhibitoire: le pourrissement. Une coque en pin tient à peine quelques
saisons. Une variante nord-américaine, le pitchpin, ne présente pas cet inconvénient. Ce conifère
coloré est fréquemment oeuvré par les Hiribarren, mais son coût a été jugé trop élevé par Krispín et ses
compères.
Le bordé, qu’il soit parachevé ou à demi posé, fait à présent fonction de moule. Les charpentiers y
introduisent en force les membrures, autrement dit la carcasse, l’ossature du navire: kostillak. Ces pièces
sont étuvées (on dit communément: egosiak, bouillies) avant d’être ployées. Elles sont en acacia. Un rivetage
de cuivre solidarise tous ces éléments en bois.
498
1951. Pêche du thon à l’appât vivant: des matelots aux
cannes, d’autres gaffent les thons qui ont mordu (à gauche);
des jets d’eau brouillent la surface.
499
Quelques semaines ont passé. Il y a maintenant suffisamment de membrures installées pour assurer la
rigidité de la coque. Les charpentiers peuvent démonter et ranger les gabarits. Ils seront plus à l’aise pour
travailler. Et quand tous les membres sont à poste, ils rivettent toute la charpente. Puis ils assemblent les
serres internes, c’est à dire les éléments horizontaux qui ceignent la coque à différentes hauteurs. Enfin, ils
disposent et boulonnent dans cette conque les viviers d’aluminium pour l’appât vivant, les réservoirs pour
le mazout, l’huile, l’eau douce...
C’est décidé, ce bateau s’appellera Bidassoa II. Mais, dès que l’ancien aura été échoué dans une vasière,
comme le prévoit le code maritime pour donner quelque chose en pâture à d’éventuels créanciers, on
continuera de dire: Bidassoa, tout simplement. A ce stade, le bâtiment mérite bien son nom basque: untzia,
qui signifie également: vase, récipient, contenant. Abeak, les barrots de pont en chêne (les poutres,
pourrait-on dire) lui donnent sa belle apparence de vaisseau ponté. Les lames en sapin du nord, un bois
qui gonfle très vite et assure une étanchéité parfaite, sont posées, formant un plancher dans lequel on
préserve une large écoutille. L’installation puis le remplacement éventuel des machines (moteurs principal
et auxiliaire, centrale électrique, compresseur, pompes) se feront par là. Pour l’heure, les charpentiers et le
mécanicien retournent à fond de cale poser le bâti du Poyaud de propulsion. Quand le moulin sera mis en
ligne et boulonné, accouplé à l’arbre de couche, ils poseront la passerelle de navigation, les câbles et chaînes
du gouvernail et des commandes mécaniques.
Le thonier qui occupe le hangar de Socoa est-il terminé? S’il avait été bordé à tapisser, il le serait presque.
Bordé à virure passée, Bidassoa montre encore une coque ajourée. Les charpentiers vont engager,
entre les premiers bordés maintenant secs, les lames intermédiaires manquantes. Il restera à calfater les
joints au fil d’étoupe, à mastiquer, peindre, boulonner les crépines des prises d’eau, poser l’hélice et le
gouvernail, etc...
La construction de Bidassoa II a mobilisé jusqu’à vingt personnes. Mais elle n’a pas demandé un outillage
considérable: un grand métier, scie à grumes débitant les pièces maîtresses, deux scies à ruban pour
tailler les bordés et les membrures, une raboteuse, une dégauchisseuse, une toupie, une mortaiseuse pour
l’égalisation des surfaces et les assemblages, et enfin une étuve...
Le bois travaillé à Socoa est souvent d’origine locale. Plusieurs fois dans l’année, les Hiribarren vont
eux-mêmes choisir des arbres sur pied, à Sare, Souraide ou Saint-Pée, distants de vingt-cinq kilomètres. Ils
négocient avec les propriétaires, généralement des agriculteurs. Ceux-ci prennent en charge l’abattage et
le transport des grumes derrière un attelage de boeufs, véritable expédition de plusieurs jours dans laquelle
les paysans s’engagent avec vivres et couchage. Les bois exotiques, sapin du nord, pitchpin du Canada
ou de l’Orégon, acajou, sont achetés à des grossistes de Bayonne ou des Landes...
Le ployage des membrures est la partie délicate d’une telle construction. L’acacia doit être exempt de
noeuds, faute de quoi il cassera à la flexion. Les membres sont bouillis une demi-heure, et mis en place
avant refroidissement. Quatre hommes dans la coque béante, quatre à l’extérieur, d’autres encore à l’étuve
sont nécessaires pour cet exercice. Les Hiribarren et leurs aides démontrent ici une grande virtuosité. Ils
sont, à juste titre, considérés comme les artistes et les seigneurs de Socoa, ce quartier périphérique de
Ciboure où se dresse le chantier.
Un bateau neuf, cela se fête. Ce que l’on appelle ici barkuaren bataioa (expression qui déplaît à l’abbé
Cachenaut, curé de la paroisse: on ne baptise pas un objet, aussi beau et pourvoyeur d’avenir soit-il) consiste
en une bénédiction par l’abbé Arnaud Idiartegaray, aumônier des marins (un prêtre atypique qui,
avec l’instituteur public Jean Carricaburu, composa une prestigieuse équipe de pelote désavouée par
l’Evêché et le Rectorat), un petit discours de Vincent Letamendia et la présentation à l’assistance des
parrains: Julita Retegui, deuxième fille du mécanicien, et Jean-Roger Larrarté, troisième enfant du patron.
A ce propos, il convient de rectifier une conviction largement répandue chez les pêcheurs: ces deux jeunes
gens ne deviendraient pas automatiquement propriétaires du bateau si les trois armateurs venaient à disparaître;
le Code Civil français ne s’accommode pas d’un dispositif aussi convivial.
Un nouveau bateau s’ajoute donc à la flottille de Ciboure et Saint-Jean qui va bientôt compter cent
quatorze unités, parmi lesquelles plus de soixante nouvelles. Bidassoa part en pêche et satisfait les
espérances que l’on a mises en lui. Ses captures n’atteindront jamais celles de l’inspiré Bégnat qui, une
saison, s’offrira le luxe de capturer deux cents tonnes de thon. Mais avec trente-cinq à quarante tonnes
annuelles, il se situera dans le peloton de tête des bateaux classiques de dix-huit mètres à cul de
trainière.
Kesús Larrarté est un patron réputé compréhensif et tolérant (aujourd’hui, l’on dirait qu’il est cool). Il
exerce sur ses matelots et ses mousses successifs une autorité bonhomme. En cas de problème, il descend
Marc Larrarté
de sa passerelle et montre comment doit s’effectuer une manoeuvre. Son contraire absolu, dit-on sur le
quai, est le patron E., un obèse brutal, grossier, toujours prêt à insulter ses hommes et à mettre en doute
la fidélité de leur femme. Ce tyran est si détestable que, le jour où il perdra l’équilibre et ne pourra relever
seul ses cent-quarante-trois kilos, ses matelots le laisseront gigoter sur le dos comme un gros hanneton
pendant plusieurs heures, jusqu’à ce que le bateau rentre au port.
C’est pour la personnalité de Kesús, mais aussi parce que le Bidassoa obtient de bons résultats, que de
nombreux matelots sollicitent un embarquement. Ceux qui sont agréés ne le regrettent pas. Ils se perfectionnent
rapidement et gagnent bien leur vie. Au fait, comment s’opère la répartition des sommes qui
proviennent de la vente du poisson?
Quand il a fait le plein de sa cale, ou épuisé son stock de peita, de glace ou de vivres, ou quand le
patron juge opportun d’aller vendre ce qu’il a capturé, le thonier retourne au port. Ses captures sont
débarquées par les marins: qui n’a admiré ou photographié ces hommes solides, disposés tous les deux
mètres sur l’escalier et le quai, qui se passent l’un à l’autre, à la manière d’un ballon de rugby, des thons
de vingt kilos et plus? Prise en charge par l’encan, la cargaison est soumise aux enchères des mareyeurs et
des patrons de conserveries. Sur la somme obtenue le bateau, entité morale, paie à la masse un certain
nombre de taxes et de frais: la rémunération de l’encan, les redevances dûes à la Chambre de Commerce,
le rôle (charges administratives), les cotisations sociales, le carburant, les lubrifiants, la glace et les vivres. Il
reste une certaine quantité d’argent, qui est répartie entre l’armement (Letamendia, Retegui, Larrarté, les
trois quirataires du Bidassoa), pour rémunérer l’investissement, constituer des réserves, etc... et l’équipage,
qui perçoit de la sorte le salaire de ses efforts.
40 % vont à l’armement et 60% à l’équipage. D’autres armateurs de pêche inversent ces proportions:
équipage 40%, armement 60%. D’autres encore recourent à différents barêmes, 45/55, 50/50 ou 55/45
et même, comme pour Bégnat et Robert Michel III, à une répartition en 31 lots, 14 pour l’armement, 17
pour l’équipage! Pour une même valeur de captures, on peut donc observer, d’un bateau à l’autre, d’assez
spectaculaires différences de rémunération. Ainsi, en 1959, Bidassoa et le thonier du patron P. capturent
chacun trente-cinq tonnes de thon, qu’ils vendent à des prix moyens très comparables, 185 et 187 F
le kilo. Campagnes identiques au terme desquelles, nonobstant, un matelot de P. totalise en fin de saison
125.200 F, alors qu’un marin du Bidassoa a touché 188.600 F, 50% de plus. Dans un cas, la rémunération
du capital est jugée prioritaire, dans l’autre cas, c’est celle des hommes d’équipage.
L’argent de l’équipage est distribué, généralement le samedi, au cours d’un cérémonial que l’on appelle
manta ou mantta, ce terme désignant également le montant de la somme perçue par chacun (– J’ai touché
un joli mantta la semaine dernière, dit-on).
Il est dix-sept heures. Les hommes repartent de chez eux. Voici trois heures, ils ont accosté, débarqué le poisson,
nettoyé le bateau. Ils ont empli les cuves à mazout et mouillé le bateau à sa place réservée, au milieu de la
darse. Ils sont rentrés faire toilette. Maintenant, ils se dirigent vers la place du Fronton. Ils sont attendus Chez Bittor,
le café tenu par Madame Muguerza, dite Marie-Jeanne Belza, vers lequel Kesús marche de son côté.
Le matelot Loulou Etchechoury a fait exception. En sa qualité de diruzain, il est passé à l’encan relever
les ventes de la semaine. Il a noté les sommes retenues par la coopérative pour le gas-oil, l’huile, les petites
pièces mécaniques, et celles encore dûes aux avitailleurs pour les vivres, les boissons et le pain. Ensuite,
il a pris de l’argent liquide dont Vincent Letamendia a retiré, quelques heures plus tôt, une épaisse liasse
à la banque. Maintenant, Loulou s’isole au fond du café, avec du papier et un paquet d’enveloppes. Il
fait et refait les comptes, puis reporte les chiffres vérifiés sur une feuille quadrillée de manifold. Recettes,
frais de coopé et d’encan, rôle, versements à l’ENIM (l’Etablissement National des Invalides de la Marine),
etc... Le reste, il le partage entre l’armement, propriétaire du bateau, 40%, et l’équipage, 60%. Puis il subdivise
ces 60%, la part d’équipage (la masse salariale, en somme): un point et demi pour Kesús, le patron,
en sa qualité de marin-chef, et non plus d’armateur, autant pour Sébastien le mécano, un point pour chaque
matelot, un demi pour Jean-Claude Olascuaga, c’est à dire Aña, le mousse. Loulou vérifie ses coefficients,
sans perdre son calme.
Kesús a pris place à sa table favorite. Marie-Jeanne apporte à boire. Loulou paie la tournée, au titre des
frais communs. Puis il pose ses comptes sur la table. Les marins font mine de ne pas voir la feuille sur
laquelle il s’est appliqué. Ils ne méprisent pas la peine qu’il a prise, ils lui font confiance, c’est tout. Aña
verse à boire au patron, au mécano, aux matelots, à lui-même. La pseudo-indifférence des hommes lui
donnant quitus, Loulou fait circuler les enveloppes nominatives. Les matelots y trouveront les sommes qui
leur reviennent, au franc près. Ils empochent sans ouvrir. Certains remettront la totalité à la femme qui
tient leur intérieur, épouse, soeur ou mère. D’autres feront d’abord un petit prélèvement, mantta ixila, la
part muette.
500
501
1953. Des marins en attente d’embarquement pêchent
le muge Murgil ramada dans le port. Au fond, le thonier
Sainte Thérèse de Georges Olascuaga 'Zaputza'.
1955. Le thonier
Bidassoa II rentrant
d’une bénédiction de
la mer, le 11 novembre
1955: à bord, l’équipage,
des passagers,
femmes et
enfants, la famille
Larrarté; des personnalités
et des curieux
sur le quai.
1956. Jesús Larrarté,
patron (à gauche),
avec Jacques Pucheu
Ordaña, autre patron
de pêche, Mercedes
Larrarté et Gomercinda
Saint-Lan à bord du
Bidassoa II à la fin
d’une marée.
Marc Larrarté
Les enveloppes ont disparu. Loulou replie ses paperasses. Il les confiera à Vincent Letamendia, archiviste
de l’armement. Puis il se mêle à la conversation. L’équipage peut aborder bien des sujets, rugby, pelote,
élections, faits divers, météo, en évitant de s’échauffer... Mais il n’évoque aucune affaire de coeur, il ne
parle pas d’argent, il ne médit de personne. Au bout d’un quart d’heure, Kesús lève la séance. Les marins
s’en retournent à pied, devisant comme si de rien n’était, alors qu’ils viennent de percevoir la contrepartie
d’efforts, de peines, de fatigues et d’angoisses dont les travailleurs terriens n’ont pas la moindre idée.
Peine et fatigue auxquels certains ne manquent pas de se dérober, comme toujours dans les périodes
d’effervescence. Le thon est réellement abondant. Malgré cela (si l’on excepte des crises sporadiques), il se
vend à bon prix. Des armateurs, des patrons commencent de se constituer de jolies cagnottes, on parle
même de fortunes. Alors certains cèdent à la facilité. Ainsi naît une combine que l’on appellera plus tard
atún-peseta, le thon-peseta.
Le scénario en est aussi rustique qu’efficace. Les pêcheurs de Pasajes, Fontarabie, Donostia ou Guetaria
capturent eux aussi du thon. Mais ils l’écoulent à 55 francs le kilo (l’équivalent en pesetas, naturellement)
alors que les Français en obtiennent 170 à 200 francs. Pourquoi n’achèterait-on pas le thon des
Espagnols autour de 90 FF quand les garde-côtes sont occupés ailleurs et, ni vu ni connu, ne l’écouleraiton
pas à l’encan de Saint-Jean à 170/200 F? Tout le monde y gagnerait. Aussitôt imaginée, aussitôt mise
en oeuvre, la manoeuvre, qui implique une douzaine de patrons cibouriens, va finir par indigner les vrais
pêcheurs et les magouilleurs vont se faire sérieusement tancer.
Les patrons cibouriens n’ont pas oublié la mésaventure sardinière d’il y a sept ans: exploitation effrénée,
diminution des captures, crise... Le phénomène les préoccupe tellement qu’ils ont décidé d’offrir,
collectivement, un beau et bon bateau, le Donibane, que barre le très respecté Jean Passicot, aux scientifiques
de l’Institut des Pêches afin qu’ils apportent une explication à ce phénomène. Le résultat a été maigre,
les chercheurs, parmi lesquels le Professeur François Doumenge, actuel directeur du Musée Océanographique
de Monaco, n’ont rien trouvé de probant. Mais, ayant prouvé la fiabilité des engins, ils
convaincront les pêcheurs cibouriens de s’équiper en gonios, radars, sondeurs et autre électronique.
Dès 1955 donc, comme si l’affaire sardinière n’avait pas servi de leçon, ces mêmes patrons se lancent
dans une spectaculaire course à l’armement. Puisque l’on pêche bien, puisque l’on gagne convenablement
sa vie, on investit pour gagner encore plus. Des flots d’argent de toutes provenances sont placés
dans la pêche thonière. Dans un premier temps, on rend le bateau plus performant, mais aussi plus sûr.
Jesús équipe le Bidassoa d’une radio puissante, d’un récepteur gonio, d’un sondeur, plus tard d’un radar.
Les manoeuvres sont facilitées par un tambour mécanique pour haler zerra, la coulisse qui ferme le filet
502
1956. Abondance: deux-cents tonnes de thons
sur le quai.
503
bolinche et empêche les sardines de s’enfuir; et par le power-block, une grosse poulie hydraulique qui permet
de remonter le filet sans peine.
D’autres vont plus loin. Une fois encore, ils bradent des bateaux presque neufs pour faire construire
des thoniers pharaoniques de vingt, vingt-deux, vingt-quatre mètres, dont les cales pourront recevoir quarante
tonnes de thon... à condition de les capturer! Certains navires sont si excessifs, si cambrés, avec une
tonture tellement forte que les manoeuvres n’en sont pas facilitées, bien au contraire, et qu’on les surnomme
plàtanos, bananes. Des armateurs font appel aux chantiers du Guipuzcoa et de Biscaye, mieux
équipés pour ce gigantisme que les Hiribarren, Sansebastian et Marin qui oeuvrent à Ciboure dans des
locaux somme toute exigüs.
En 1955 les premiers clippers sont lancés à La Rochelle, à Gujan-Mestras. Leur ligne générale est celle
des tuna clippers ou tuna catchers en service dans les eaux californiennes: avant abrupt et massif (l’intérieur
renferme d’assez vastes postes d’équipage), passerelle avancée, pont de pêche long, large, dégagé
et bas sur l’eau. Leur aménagement, par contre, traduit l’expérience désormais incontestable des patrons
autochtones. Quelques-uns, Bixintxo, Gaby Bernard, Michel Joseph, L’Aigle des Mers... sont en acier et
l’on se demande si le métal, transmettant les vibrations des machines, ne fera pas fuir le thon (non, heureusement!).
La plupart sont en bois, Tutina, Carmenchu, Egun On... ni moins beaux, ni moins bons, à tel
point que le chantier Hiribarren, assez tardivement, va se laisser tenter et construire un clipper: ce sera
L’Ange de Mer, vingt-trois mètres, lancé en 1958.
Ces bateaux originaux coûtent deux à trois fois plus chers que les traditionnels de dix-huit mètres tels
Bidassoa. Certes, les capitaux de proximité convergent toujours vers la pêche maritime. Mais les cagnottes
et les bas-de-laine particuliers ne suffisent plus. Le Crédit Maritime, une banque coopérative fonctionnant
sous le contrôle et avec une dotation de l’Etat, intervient de plus en plus fort dans le paiement des travaux.
Très vite, on s’aperçoit que les captures réalisées dans le golfe de Biscaye (Bixintxo: 73,5 T; Michel
Joseph: 68,4 T; Tutina: 57,6 T; Carmenchu: 71,5 T; Izurdia: 51 T) ne permettront pas de rembourser les
emprunts. Il faudrait pêcher sur le même rythme, mais pendant six mois, ou huit, ou même douze, au lieu
de quatre. Une nouvelle problématique se présente aux patrons-armateurs de Ciboure: où trouver de
telles pêcheries?
La réponse ne tarde pas: au Sénégal. Ce pays d’Afrique de l’Ouest est encore une colonie française.
Ses eaux sont particulièrement poissonneuses: on raconte que les thons se pressent autour des bateaux et
sautent à bord à la première sollicitation. Bref, un fol espoir, contemporain d’une sourde inquiétude.
Organisés et réalistes, les Cibouriens décident d’aller voir. Deux amis de Jesús qui furent comme lui
militaires à Dakar, Berrouet et Oficial, se sont portés candidats avec leurs bateaux Alegera et Danton cofinancés
par l’industriel Rémy Badiola. Ces unités d’à peine quatorze mètres, il serait imprudent de les
engager dans une telle traversée qui comprend, notamment, la pénible remontée du golfe de Biscaye jusqu’en
Galice, jusqu’au Cabo Finisterre. Alors, on les embarque sur le cargo hollandais Fraü Bohmer et tout
se joue à partir de Dakar: de belles pêches de 1800, 2000, 1400 kg par journée, quelques difficultés à se
procurer le peita (sardinella aurita, une sardine différente de celle d’ici, que les Basques appelleront lolita),
une fabrique de glace insuffisante et surtout rien, rien, rien pour stocker et transformer le thon capturé.
En d’autres termes, si l’on veut rentabiliser les clippers, il faudra aller pêcher au Sénégal. Mais pour y
pêcher, il faudra apporter avec soi toute une logistique.
Au retour de ces éclaireurs, deux questions fondamentales se posent: – qui veut aller travailler en Afrique,
l’hiver, quand le thon déserte le golfe de Biscaye? – l’ensemble des pêcheurs de Saint-Jean et Ciboure
peut-il, veut-il ou doit-il soutenir financièrement cette entreprise qui ne bénéficiera qu’à certains d’entre
eux?
Le moment est venu de faire apparaître un personnage déjà bien connu et apprécié dans le milieu
maritime: José Basurco. Cet homme a tout fait, il sait tout faire, ce qu’il ne sait pas, il l’invente. Il a fait
reconnaître la pêche basque aux gouvernants qui ne juraient que par les Bretons. Il a été l’interlocuteur
pugnace des ministres et des présidents. Il va maintenant s’avérer un organisateur de premier brin. Marin,
mécanicien du thonier Altxa Mutilla, armateur, président depuis 1952 du syndicat des marins de Saint-
Jean et Ciboure, promoteur de la modernisation du port, il va parler d’égal à égal avec les dirigeants du
Sénégal, y créer une usine, la remarquable Conserverie du Mali dont les éléments, tubes, compresseurs,
chaînes... transportés de Ciboure à Dakar par les thoniers eux-mêmes, seront assemblés en trois mois sous la
houlette des talentueux Jojo Harguindeguy et Jeannot Etchechoury. Il va diriger cette usine, acheter au nom de
l’ensemble des pêcheurs un rafiot allemand et le transformer en congélateur (Sopite, 56 mètres) qui rapatriera
sur Ciboure une partie du thon pêché en Afrique, et rejouer le même scénario avec l’Iraty, un ex-transporMarc
Larrarté
teur de chars de 105 mètres racheté au Canada. Il va concevoir et organiser les services d’infirmières, de filetières,
de personnels administratifs délocalisés à Dakar, pourvoir à leur nourriture et leur hébergement... Plus
tard, retiré des affaires cibouriennes, il donnera un bel essor aux pêcheries thonières des Seychelles. La chronique
historique s’accommode assez mal du culte de la personnalité, mais force est de reconnaître du génie à
José Basurco. Ce qu’il n’a pas à proprement parler créé, il l’a débusqué ailleurs et il l’a basquisé. Avec, il est vrai,
le soutien d’une équipe soudée, quasiment inféodée à ce personnage charismatique.
Sous la houlette de José Basurco, donc, les équipages s’apprêtent à investir les eaux africaines. Les 12
et 14 novembre 1955, les équipages de Roger Bellocq, Xipri Etcheverria et Jean Alsuguren, à bord des trois
clippers Curlinka, Bixintxo et Izurdia quittent Ciboure. Ils pêcheront en onze semaines trois fois plus qu’ils
ne capturent en quatre mois de pêches métropolitaines.
Résumons ce qui va suivre: trente-cinq équipages, en moyenne, iront chaque hiver pêcher au Sénégal;
puis certains se lasseront de cet éloignement, et le nombre diminuera; le Sénégal acquerra son indépendance,
ce qui changera les conditions; pour finir, quelques armateurs de clippers s’installeront à l’année à
Dakar, formant et employant des équipages autochtones. En 2000, leurs successeurs (le petits-fils dans le
cas des Luberriaga, armateurs des Maria, Sardara puis Ernai) ne sont plus que sept à persévérer. S’ils ne
sont plus les Crésus qu’on a cru voir en eux, ils gagnent honorablement leur vie dans un métier difficile,
mais qui les autorise à regarder le soleil en face.
Les soixante-dix autres bateaux qui complètent la flottille cibourienne de 1955 se répartissent, quant à
eux, une manne thonière qui n’est plus aussi abondante, parce que décimée par plus de six cents bateaux
étrangers postés entre Açores et Cap Finisterre. Grâce à une audacieuse politique de qualité, initiée elle
aussi par José Basurco, le thon des Basques se vend relativement bien. Mais cela ne suffit pas. Les équipages
doivent renouer avec la pêche des sardines qui n’avait pas été délaissée, mais un peu déconsidérée,
depuis que les usiniers avaient armé des bateaux au Maroc pour alimenter leurs chaines; et même celle de
l’anchois, que des saleurs méditerranéens et espagnols achètent à un prix tout juste décent. L’un dans
l’autre, les équipages s’en sortent, financièrement parlant.
Pour Jesús, le choix de ne pas aller à Dakar s’impose de lui-même. Ce n’est pas uniquement la taille
modeste du Bidassoa qui joue. Le Vagaband, de dimensions comparables, fera plusieurs campagnes africaines
sans encombre. Non, Kesús a fait un calcul rapide: le Bidassoa rembourse ses emprunts sans difficulté
(il apurera sa dette en moins de trois ans au lieu des sept prévus); il a toujours pêché d’une manière
équilibrée, sans que le thon l’emporte sur la sardine ou l’anchois; si une espèce vient à manquer, il peut
toujours se rattraper avec une autre. Pourquoi irait-il affronter la distance, un climat rude, des conditions
de vie hasardeuses? Pourquoi les hommes abandonneraient-ils pour six mois femmes et enfants? Cela a
vite été décidé: pas de campagne africaine pour Bidassoa.
504
1959. Les thoniers au
mouillage dans la
darse de Ciboure...
juste avant les travaux
d’agrandissement.
505
Naturellement, les équipages étant mobiles, chaque matelot est libre de poser sac à terre et de chercher
une place dans un bateau en partance. Aucun de ceux qui travaillent sous les ordres de Krispín n’usera
de cette possibilité pour se lancer dans l’exotisme.
Quoi qu’il en soit, comme les deux tiers des marins de Ciboure, c’est de loin que Kesús observe les
résultats de ceux qui sont partis. Et ces résultats sont bons. Des mukitsu qu’il a formés en qualité de mousse
reviennent de campagne, à peine âgés de vingt ans, avec assez d’argent pour s’acheter cash une jolie
voiture, pour acquérir un terrain et commencer à faire construire leur villa, comme ils disent, abandonnant
le terme familier de maison pour adopter le vocabulaire des aberatsa. A de tels détails, Kesús et les autres
comprennent qu’une page de l’histoire maritime cibourienne est en train de se tourner.
Les autorités françaises estiment-elles que les pêcheurs vivent un peu trop librement? Elles décident
soudain d’intervenir, d’imposer des normes, des barêmes, des conditions. Comme plusieurs de ses compères,
Jesús Larrarté est monté en grade, passé de l’état de matelot à celui de patron, grâce à des dérogations
largement accordées par l’Inscription Maritime. Titulaire depuis le 14 octobre 1947 du permis de
conduire pour navire à moteur ayant une force motrice égale à 100 CV, essence et gas-oil, il n’a pas eu
d’autre épreuve à subir, nonobstant la motorisation croissante de ses bateaux et l’élargissement progressif
des zones de pêche. En d’autres termes le savoir-faire a suppléé les diplômes. Commandait un bateau
celui qui savait le faire, celui qui en avait fait la preuve, celui qui avait sur ses hommes une espèce d’autorité
naturelle et un ascendant que personne ne se donnait la peine d’expliquer.
D’un seul coup, l’administration décide qu’il faut que ça change. Maintenant, pour commander, il faut
un réel diplôme, un papier filigrané signé par trois ou quatre personnalités, ce que l’on appelle en France
une peau d’âne. Pour Jesús, cette décision est une catastrophe. Rappelons-nous: à part quelques leçons
du maese cojo de Fontarabie, il n’a guère fréquenté l’école; il sait lire une carte pour l’avoir appris sur le
tas; d’ignorer la variation des déclinaisons magnétiques ne l’empêche nullement de retrouver sans aucun
instrument le Fer à cheval, un banc sous-marin très poissonneux à soixante milles dans l’Est d’Arcachon.
Voilà que cet autodidacte et plusieurs autres patrons de pêche réputés doivent se plonger dans des ouvrages
savants auxquels ils ne comprennent que pouic, faire des règles de trois, tracer de savantes courbes et
savoir al dedillo que l’angle horaire d’une étoile répond à la formule Ahao=Ahso + AV !
Kesús ne s’est jamais plaint de cette époque, dont le résultat devait, en somme, officialiser un savoirfaire
que nul n’aurait osé lui contester. Mais ses proches savent bien qu’elle a été l’une des plus difficiles
de sa vie. Lui qui avait sans renâcler affronté des tempêtes et de longues périodes sans poisson, il a réellement
beaucoup souffert. Heureusement, il s’est trouvé pour lui apporter une assistance adaptée à ce
qu’il désignait lui-même comme sa rusticité (nere salbaikeria, disait-il), pour concilier la validation pédagogique
et l’ample savoir déjà détenu par ce marin de quarante-cinq ans, un enseignant particulièrement
avisé, patient et chaleureux, Monsieur de Saint-Germier. Grâce à lui, Kesús parvient à assimiler des flots
de théorie et obtient, le 28 mars 1958, le certificat de capacité pour le commandement d’un navire de
pêche...
A la proclamation des résultats, Maurice Le Floc’h, un Breton taciturne, patron intérimaire du Bidassoa
jusqu’à ce que Kesús fût en règle, dira:
– Gast! ces fayots, ils voudraient dégoûter les gens du métier, ils ne s’y prendraient pas autrement.
Fayot, qui désigne le haricot en argot français, est le surnom dont on affuble les marins militaires de
carrière, parce qu’on les soupçonne de fayoter, c’est à dire d’intriguer pour monter en grade.
Conséquence que n’avait pas prévue Krispín: l’obtention de ce diplôme le fait accéder à une catégorie
supérieure de salaire forfaitaire. Le moment venu, le montant de sa retraite sera donc plus confortable.
Le lecteur a peut-être l’impression qu’il suffisait aux arrantzale de Ciboure et Saint-Jean de pêcher, et
que tout le reste allait de soi. Illusion. Les captures de sardines, comme celles de thon, se sont épisodiquement
accompagnées de méventes, parce que les mareyeurs qui expédiaient leur poisson aux quatre coins
de France, parce que les conserveurs qui le mettaient en barils ou en boîtes pour le distribuer dans l’Europe
entière, soudain n’en voulaient plus, et faisaient supporter aux pêcheurs les avatars d’un marché qu’ils
ne savaient pas maîtriser. Lorsque, sur la fin de sa vie, l’on demandait à Jesùs quel avait été son plus mauvais
souvenir professionnel, imaginant qu’il allait évoquer une tempête ou la mort par noyade d’un ami
dont le bateau n’avait pas pu esquiver la galerne, il répondait:
– Oh, il y en a plusieurs, et toujours la même chose: nous avions rapporté de la belle et bonne sardine,
les acheteurs n’en voulaient pas, et nous étions obligés de balancer notre cargaison à la mer, alors qu’il y
avait pas loin d’ici, dans la population espagnole, des gens qui ne mangeaient pas à leur faim!
Marc Larrarté
Image forte, pénible, désespérante que celle de dizaines de caisses de bon poisson rejetées dans le bassin
du port, à une époque où n’existait aucun organisme de retrait ni aucun entrepôt frigorifique. C’était
pire encore qu’en 1934, quand les entrepôts des conserveurs débordaient jusqu’à ce que l’Italie rachetât
tout pour nourrir ses troupes engagées en Ethiopie: du moins, là, les pêcheurs ne sortaient pas, il y avait de
la misère, mais pas cet insupportable gaspillage, ce mépris pour le travail accompli, ce gâchis écologique.
Dès qu’ils ont pu, les pêcheurs de Ciboure ont essayé de parer de telles avanies, par exemple en construisant
l’entrepôt frigorifique déjà évoqué. Ils se sont aussi prémunis contre les risques professionnels, les
accidents, les méventes, les fortunes de mer, en tissant de nombreux systèmes de solidarité dont certains
rajeunissaient les prestations assurées, en Euskadi-Sud, depuis des temps immémoriaux, par les kofradia
de pêcheurs.
A dire vrai, pêcheurs avant tout, formés à la pêche et rien qu’à cela, les gens de mer n’eussent pas été
aussi bien lotis s’il ne s’était trouvé dans leur milieu des personnalités fortes pour imaginer ou adapter, puis
mettre en place des structures d’entraide. Sans vouloir, une fois encore, céder au culte de la personnalité,
il faut signaler ici deux phares: le premier est l’aumonier des marins Arnaud Idiartegaray qui, avant guerre,
implanta le syndicalisme chrétien à Saint-Jean-de-Luz, sur le modèle d’une oeuvre colossale réalisée en
Bretagne et en Vendée par le réputé Père Le Bret; le second est l’inévitable José Basurco, dont on sait qu’il
était de tous les combats. Grâce à eux, le poisson si bien pêché n’était pas laissé sur le quai, il était vendu
dans les meilleures conditions possibles, et le flux financier qu’il générait était réparti dans l’intérêt de l’ensemble
des marins. Partis de La Basquaise,une coopérative créée en 1945 pour faciliter l’équipement des
bateaux, Basurco et ses fidèles avaient su constituer un réseau tentaculaire et d’une parfaite efficacité qui
englobait aussi bien la coopérative Itsasokoa (financée par 1.200 pêcheurs à raison de cent francs per
capita) qu’une garantie de ressources au bateau qui interrompait sa pêche pour remorquer un collègue en
panne de machine!
Jesús, qui n’était guère porté sur les paperasses et les démarches, était conscient de cela. Comme
95% des gens de mer, il adhérait avec conviction, mais non sans lucidité critique, aux propositions qui lui
étaient faites et il cotisait assidûment. Pour lui qui avait bricolé et trimé afin de nourrir et vêtir ses cadets
dans la Fontarabie des années 1920, cette solidarité était une marque de progrès, mais surtout un signe
de dignité.
Dans un domaine différent, technique celui-là, d’autres personnages épaulent ceux qui pêchent. Imaginons
ces pêcheurs compétents soudain privés de leurs astucieux engins: ils seraient bien handicapés. Eh
bien, pour entretenir et réparer ce que la science halieutique désigne d’un nom charmant et poétique, les
arts de pêche, il y a des personnages indispensables: les saiero ou garçons de chai. Celui qui est attaché à
l’armement du Bidassoa s’appelle Pierrèch Jaureguiberry. C’est un quadragénaire trapu et rieur, toujours
entouré d’une nuée d’enfants qu’il promène volontiers sur la charrette à bourricot destinée à transporter
la bolinche. Voici l’une des journées de ce personnage.
A l’aube, Pierrèch s’est occupé de Margot, l’ânesse: flotte et picotin, un petit coup d’étrille sur la robe
et changement de la litière. Puis il a nettoyé la charrette à pneus de camion, encroûtée d’écailles et de
sang de poisson depuis la dernière manipulation. Maintenant, il prépare le gros travail du jour: tanner la
bolinche que le thonier va débarquer dans la matinée. Il va se faire aider par le fils de Kesùs, qui n’a pas
école ce jour-là et qui, comme souvent, est venu lui rendre visite.
L’opération se déroule au chai de l’armement (saia), une longue bâtisse à deux niveaux dans laquelle,
avant la guerre, Letamendia construisait des bateaux à vapeur pour lui-même et son collègue l’armateur
Plisson. Ce local est idéalement situé sur l’avenue Jean Jaurès, à trois cents mètres du port. Certains
confrères de Pierrèch doivent, eux, se contenter de hangars venteux perdus dans le quartier rural de Galzaburu
ou même, pour l’un d’entre eux, d’un ancien appartement dont on avait abattu les cloisons pour
abriter une meute de chasse avant de l’abandonner dans un triste état.
Ici, l’étage abrite une filèterie vaste au parquet blond où l’on peut aisément déployer papuak, les nappes
de filet, pour les ramender à plat. Aux murs sont accrochés des rouets, tourniquets et bobines garnis
de cotons calibrés. Cet espace est le domaine de Nadine et Julita, filles du mécanicien Sébastien Retegui
et saregile de l’armement.
Au niveau inférieur se trouvent l’écurie de Margot et divers espaces de rangement. Il y a surtout une
grande pièce dans laquelle le saiero a disposé tout un appareillage que l’enfant se plaît toujours à répertorier:
– une cuve en cuivre de six cents litres sous laquelle on peut entretenir un feu de bois et de briquettes;
– un autre bac, en pierre celui-là, de cinq cents litres, relié au premier par une tuyauterie de cuivre
que barre un énorme robinet; – une table de bois massif, longue de trois mètres, légèrement déclive,
506
507
dont trois côtés sont ourlés d’un rebord et dont le quatrième surplombe légèrement le réservoir de pierre,
meuble contre lequel viendra se ranger la charrette de Margot.
Le saiero a chargé l’enfant d’alimenter un feu sous la cuve de cuivre. Dans la demi-tonne d’eau douce
qui monte en température, il plonge un sachet de filet contenant le cachou, un pigment à base d’écorce
de chêne. Puis les deux gars vont avec Margot chercher le filet à traîter. On imagine la fierté qu’éprouve
l’enfant à traverser la bourgade juché sur la charrette comme Ben Hur campé sur son char.
La carriole vient à reculons jusqu’au bord du quai. Les matelots du Bidassoa se disposent sur deux
rangs pour faire avancer entre eux, sans qu’elle frotte le quai, la masse de la bolinche extraite du bateau.
Debout sur le plateau, le saiero dispose le filet à sa convenance.
Retour au chai. L’eau de la cuve est bien chaude. Avec une pelle de bois, l’enfant répartit le cachou qui
se déliait en minces écharpes. Ses larges pieds nus à même l’auge de pierre, Pierrèch débarque le filet et
l’étale. Il descend et ouvre le robinet de cuivre. Dès que la bolinche baigne dans le bouillon sombre, il
referme. L’enfant touille afin que toute la toile soit imprégnée.
– Hoa goxoki, ttikia, kontu emak ez erretzea! va doucement, petit, veille à ne pas te brûler, conseille
l’adulte.
Les deux gars s’accordent dix minutes pour deviser avec les passants de l’avenue. Puis le saiero hale la
senne sur la grande table de bois. Il tire en puissance, dédaignant la chaleur qui agresse ses mains. Le filet s’égoutte.
Le liquide brun retombe dans la cuve de pierre. Le gamin empoigne un seau de bois muni d’un long
manche et il en reverse une partie dans le tank métallique. Il rajoute quelques bûches pour raviver le feu.
Lorsque la bolinche ne transpire plus, les deux gars renouvellent l’opération. Ils la répéteront une fois
encore, peut-être deux, c’est à Pierrèch d’en juger. Puis ils feront tremper vingt minutes dans le même jus
l’ensemble du gréement et des accessoires. Sur la table en pente, le filet finit de s’égoutter. Pierrèch le
replace sur la charrette et l’emporte au champ.
Le champ: entretenu comme une pelouse d’agrément, ce terrain plat d’un demi-hectare est planté de
huit mâts de dix mètres, chacun armé en tête d’une poulie dans laquelle circule une drisse de chanvre. En
huit points, donc, les deux opérateurs nouent ensemble les deux ralingues du filet, celle des lièges et celle
des plombs. Ils hissent et déploient la nappe aussi clairement que possible. Ils la bougeront de temps à
autre pour en débusquer les nids d’humidité.
Tout ce travail n’est que routine dont Pierrèch, même quand il est seul, s’acquitte avec bonne humeur.
Ce qui complique sa tâche et le met en rage, c’est le temps incertain. Alors, tout en vidangeant et nettoyant
les cuves, il surveille le ciel comme un obsédé. Un nuage? Vite, il choque les drisses, brasse la toile, la
met en tas sur l’herbe et la recouvre d’un prélart. L’averse passée, il renvoie. Il donne l’image d’un caphornier
saluant les grains.
Le saiero est un employé de l’armement, au même titre que les matelots. Mais il perçoit, lui, un salaire,
alors que les autres sont payés à la part. Kesús et ses associés cotisent pour lui à la Sécurité Sociale, et
à l’ENIM pour les matelots. En plus de sa rétribution, Pierrèch reçoit quelques bonifications en nature, des
paniers de godaille que lui préparent les matelots, ou un thon offert par Kesús; il est souvent invité à la
table de l’un ou l’autre des trois armateurs et, bien entendu, il peut utiliser pour des travaux personnels
l’ânesse Margot et sa charrette, qui sont à la charge de l’armement.
L’adoption généralisée des filets de nylon va rendre inutile la fonction de saiero: il n’y aura plus de tannage;
quant aux déchirures, elles seront réparées par l’atelier Freyssengeas, qui déléguera des filetières à
bord même des navires. Pierrèch, contrairement à la plupart de ses confrères, ne sera pas licencié. Employé,
mais aussi ami des armateurs, il continuera d’être rétribué pour soulager les matelots de tâches qu’ils
n’apprécient pas beaucoup, comme celle d’enduire de coaltar la sole des plates sardinières. Là encore,
Pierrèch demeurera ouvert et enjoué, toujours disponible.
– Dieu merci, je suis en forme pour mener à bien quelques projets personnels. Je n’ai pas de dettes.
Quarante années de pêche professionnelle me donnent le droit de prendre mes Invalides. Il y a, à Saint-
Jean, Ciboure et Hendaye, quelques dizaines de mousses et de matelots qui ont travaillé sous mes ordres.
Ils sont prêts à prendre la relève. Place aux jeunes! J’arrête.
Tel est le discours que se tient, l’an 1964, à l’âge de cinquante-trois ans, Krispín Larrarté. Dans la foulée,
Sébastien Retegui, de deux ans son aîné, se retire aussi. Quant au troisième larron de l’armement, Vincent
Letamendia, nettement plus âgé, il n’envisage pas de travailler avec d’autres partenaires que ceux-ci:
il cède lui aussi ses parts.
Marc Larrarté
Bidassoa II est comme neuf. Dix ans à peine, un entretien scrupuleux, des améliorations constantes, un
équipement copieux (radio, gonio, sondeur, tambour à coulisse, power-block, moteur récent de 240 cv)
qui a fait oublier l’outillage spartiate de 1954, c’est une excellente occasion qui échoit à Jean-Baptiste
Garat, un ancien berger de Louhossoa venu accidentellement à la pêche, formé à la mécanique, puis
devenu patron et destiné à fonder l’un des armements les plus solides de Hendaye grâce au rachat d’autres
beaux bateaux comme Hirondelle III ou Endaiako Izarra.
Les matelots voient avec regret leur patron quitter la carrière. Mais la vie continue pour eux. Formés à
l’école de la compétence et d’une rigueur bonhomme, ils trouveront sans peine de nouveaux embarquements.
Les mousses qui ont travaillé avec Kesús deviendront à leur tour des patrons de pêche ou des entrepreneurs
terriens respectés, les deux plus récents étant sans doute Jean-Claude Olascuaga et Jacky Xakola.
508
1971. Jesús, 60 ans, dans son petit moteur
de 6 mètres L’Aiglon prêt pour la pêche.
Cela faisait des années que Koxé-Mari Salha, patron du Magermo, et Krispín Larrarté étaient sollicités
par des plaisanciers, amateurs de pêche sportive au thon. Pour ridicules qu’ils étaient avec leurs casquettes
d’amiral et leurs blazers armoriés, ces personnages n’étaient pas sots. Ils savaient bien qu’ils ne posséderaient
jamais les connaissances halieutiques acquises par les pêcheurs professionnels en vingt ou trente
ans de carrière. Voilà pourquoi ils aimaient s’adjoindre leurs compétences lors des prestigieux concours de
big game fishing du golfe de Biscaye.
Après quelques hésitations, Jesús prend en main la vedette de Monnoyeur, producteur d’Armagnac
dans le département du Gers. A puissance égale, 240 chevaux, Marie Louise, tel est le nom du bateau,
12,60 mètres, vingt-quatre noeuds, c’est un autre bolide que Bidassoa. Mais cela ne désoriente pas Jesús.
Saint-Jean-de-Luz, Arcachon, Lekeitio, Motrico, Laredo: Monnoyeur et lui sont partout, ils font tous les
concours, championnat de Biscaye, d’Aquitaine, d’Atlantique. Ils remportent des coupes et des vases de
Sèvres du Président de la République française que Monnoyeur, fair-play, offre à son patron de pêche.
En vérité, ces concours présentent un double degré de compétition. Officiellement, ce sont les propriétaires
des vedettes qui pêchent. Mais nul n’ignore que la réalité met en concurrence plusieurs expatrons
de Ciboure et de Hendaye, parmi lesquels Koxé-Mari Salha, qui mène le bateau de Michel Boulin,
négociant en bois dans les Landes, et Jesús Larrarté se distinguent bien souvent.
Et puis Jesús décide que c’est assez. Il y a quelque chose d’indécent, dira-t-il, à chasser les beaux thons
rouges qui ont naguère sorti la population cibourienne de la misère, pour la vaine satisfaction de figurer à
la rubrique mondaine des journaux et de glaner quelques coupes. Le thon, ce combattant splendide, doit
509
être capturé par des professionnels pour nourrir ceux qui ont faim. Krispín achète donc un canot à moteur
de six mètres, L’Aiglon, et pêche désormais pour lui-même.
Plus tard, considérant que l’Aiglon est encore bien trop puissant pour un simple loisir (il s’agit d’un
bateau presque aussi performant que L’Etoile de 1931 avec ses six personnes), il le cède à Emilio Zurutuza,
patron du clipper africain L’Aigle des Mers, et choisit une embarcation de quatre mètres, qu’il baptise
Jesús, comme le batteliku qu’il armait pendant l’occupation allemande. Il s’en servira jusqu’à l’âge de quatre-
vingts ans, allant à l’aviron avec un style très épuré, comme le montre une photo de la revue française
Le Chasse Marée. Toujours lié à la mer, à la pêche, conscient d’avoir donné et reçu, conscient d’avoir tracé
son sillage personnel dans le grand bouillonnement des choses.
Le parcours de Krispín Larrarté est exemplaire en ce qu’il est celui de plusieurs dizaines de pêcheurs
sans éducation, sans tradition armatoriale, nés à Ciboure ou à Fontarabie, promis à une désespérante
pauvreté, mais habités d’une telle afición qu’ils sont devenus des pionniers et des références dans l’art difficile
de la pêche. Si l’on y changeait quelques mots, quelques dates, noms ou lieux, le récit qui précède
pourrait s’appliquer à Paul Péry, patron de l’Ederki Da, à Bégnat Josié, à Koxé-Mari Salha, à Paul Berrouet
d’Erregiña, Gregorio et Periko Goicoechea du Pottoroa, Antonio Sagarzazu du Mariñela, ou encore Georges
Olascuaga, à des foules d’autres patrons ou matelots, amis, confrères, co-inventeurs de l’épopée sardinière
et thonière de Ciboure.
Mais ce parcours illustre des valeurs morales que, depuis 1965, le modernisme galopant et la diversification
des métiers de la mer pratiqués à Ciboure ont reléguées à un rang secondaire. Il n’est pas aisé d’en
parler sans paraître moralisateur. Alors, autant rappeler l’essence d’une conversation tenue naguère entre
un patron ondarrabitar rencontré sur le quai (J.M. Elduayen) et Jesús Larrarté.
Cela commença par une affirmation d’Elduayen: – Ziburuko mariñelek ez dituzte nagusiarik, beren
zuzendariak patroñak dira, expression d’une totale absurdité – les marins de Ciboure n’ont pas de patrons,
ceux qui les dirigent sont des patrons! – si l’on ignore la distinction fondamentale entre nagusia (à Ciboure,
on abrège: nausia) et patroña.
Nausia, c’est le patron au sens le plus commun du terme: le patron de l’usine, la fille du patron; mais
c’est aussi le maître, le propriétaire, la puissance dominante. Sur le littoral basque, on manifeste une solide
défiance envers ceux qui ont de l’argent, de l’autorité, des relations, du savoir. Ces détenteurs de pouvoir,
on les subit.
Avec patroña, c’est autre chose. Ce patron-ci commande, dirige, possède, au terme et en récompense
d’un savoir patiemment affiné, de galons gagnés par un mérite sans équivoque. Le patron d’un bateau est
passé par l’état de ses subordonnés. Il sait faire, et souvent mieux, ce que fait chacun de ses marins. Voilà
le genre d’homme à qui un pêcheur obéit naturellement.
L’expression française embarqués dans la même galère illustre cette différence de considération. Patroña
vit comme ses matelots dans l’inconfort et la promiscuité. Tout chef qu’il est, il affronte les mêmes mers
brutales, subit d’identiques engelures et de comparables coups de soleil. Il prend des décisions de vie ou
de mort en étant lui-même à la merci de leur bien-fondé. Ainsi, un jour de tempête au large d’Arcachon,
Kesús décide d’amarrer Bidassoa à la bouée d’atterrissage... par sa poupe ronde et levant bien à la lame,
ce qui maintiendra le bateau dans le lit du vent, alors que l’amarrage par la proue, très haute et dépourvue
d’écubier, le ferait andarkatu, embarder, déraper. La manoeuvre est acrobatique, mais il n’y a pas
d’autre solution, c’est ça ou affronter des lames monstrueuses pour s’écarter de la terre: chavirer, selon
toute vraisemblance. L’amarrage est réussi grâce à l’agilité du jeune Mendiburu, alias Garibaldi, qui saute
sur le flotteur avec une double aussière. Un trait de génie, l’humble courage d’un matelot, une approche
d’une grande finesse de barre sauvent les vies en danger, celles des matelots, mais aussi celle de patroña
lui-même. Le patron d’un bateau est l’homme qui montre compétence, responsabilité et solidarité physique
permanente avec ses subordonnés. Nausia, c’est un supérieur de fait. Patroña, c’est un chef à bon
droit dont on peut, à force de mérite, égaler la situation.
De là viennent des comportements très déconcertants. Lorsque Vincent Letamendia, co-armateur de
Bidassoa, avait une tâche à confier, il pouvait ordonner au saiero de s’en occuper. Pierrèch répondait alors:
– Bai, Nausia, banoa bereala, oui, patron, j’y vais tout de suite.
Mais si Pierrèch était déjà occupé, Letamendia priait un matelot, Jeannot Pérul, Edouard Poli, Manuel
Olaizola ou un autre, de s’en acquitter. Et le marin, même disponible, en référait à Kesús, patroña, son
supérieur à lui, avant d’accepter. Et dans ce cas, il disait simplement à Letamendia:
– Bai Jauna, oui Monsieur.
SOURCES
DOUMENGE, François: L’évolution de la pêche à Saint Jean de Luz, Centre Régional de la Productivité
de Montpellier, 1956.
EPALZA, Mikel et al.: «Cent ans de pêche», Altxa Mutillak, itsas gazteriaren aldizkaria, spécial n°9,
1999.
GUÉNA, Claude: «La foi et la ténacité des marins luziens...», La Pêche Maritime, n° spécial, 1954.
LARRARTÉ, Marc: «Marins d’Euskadi, pionniers de la pêche thonière européenne», Bulletin du
Musée Basque, n° 75, 1977.
LARRARTÉ, Marc: Nola giñen, monographie, mention spéciale au Concours du Patrimoine des Côtes
et Fleuves de France, Douarnenez,1998.
LARRARTÉ, Marc: enquêtes et articles personnels.
RAMOS, Christian: La pêche à Saint-Jean de Luz, Université de Bordeaux, 1962.
TOURRASSE, Guy de la: La pêche au thon sur la côte basque française et son évolution récente,
Office Scientifique et Technique des Pêches Maritimes, n° 66, décembre 1951. votre commentaire
votre commentaire